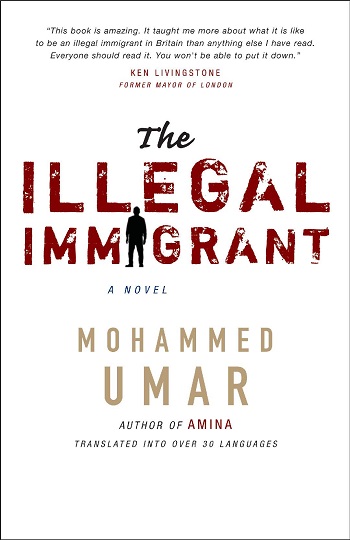Les mêmes – toujours les mêmes qui refusent d’entendre – diront qu’il y a des choses plus urgentes à faire que de se préoccuper, maintenant, des reliques, effigies et autres monuments laissés par la colonisation. Les mêmes feront valoir que le passé est passé et qu’il faut le restituer au passé.
Ils affirmeront qu’au lieu de s’en prendre aux statues érigées par l’État colonial, les Africains feraient mieux de s’attaquer aux « vraies » questions, celles que leur impose le présent – la production agricole, la bonne gouvernance, les finances, les nouvelles technologies, ou encore la santé, la nutrition et l’éducation, bref ce que, depuis près d’un demi-siècle, les Nègres s’échinent, souvent sans réfléchir, à épeler : le « dé-ve-lo-ppe-ment ».
D’autres encore iront plus loin. Ils diront que si et seulement si les indigènes s’étaient montrés capables de préserver le peu que la colonisation leur a laissé, ils se porteraient sans doute mieux aujourd’hui. Or, à peine leurs anciens maîtres partis, ils se sont attelés à détruire l’héritage que ces derniers leur ont si gracieusement légué.
Zélotes de l’amnésie
De tels raisonnements – auxquels d’ailleurs de nombreux Africains souscrivent - ont toutes les apparences du bon sens. Ils reposent pourtant sur de fallacieux présupposés.
Et d’abord, ceux qui préconisent l’amnésie sont incapables de nommer la sorte d’oubli qu’ils nous recommandent. S’agit-il d’un oubli sélectif ou s’agit-il vraiment de tout oublier du passé – tout le passé ? À quelle autre communauté humaine cela a-t-il jamais été prescrit ?
Supposons, un instant, que cela soit possible : comment, dans de telles conditions d’amnésie radicale, pourrons-nous répondre de notre nom, c’est-à-dire assumer, en toute connaissance de cause, notre part de responsabilité et d’implication dans ce qu’a été notre histoire ?
Par quels signes reconnaîtrons-nous ce que notre présent est capable de signifier ? Car, même s’il est vrai qu’une distance relative par rapport au passé est absolument nécessaire pour « faire la paix avec le passé » et ouvrir le futur, le passé n’appartient jamais qu’au seul passé.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des sociétés humaines portent un tel souci pour leur histoire et mettent tant de soin à s’en souvenir à travers des commémorations et, davantage encore, par la mise en place de maintes institutions chargées d’activer la créativité culturelle et de gérer le patrimoine national (musées, archives, bibliothèques, académies).
Au demeurant, il n’existe de communauté proprement humaine que là où la relation au passé a fait l’objet d’un travail conscient et réfléchi de symbolisation. Plutôt que d’oublier tout le passé, c’est ce travail (critique) de symbolisation du passé (et donc de soi-même) que les Africains sont invités à effectuer.
Deuxièmement, les zélotes de l’amnésie se méprennent sur les multiples significations des statues et monuments coloniaux qui occupent encore les devants des places publiques africaines longtemps après la proclamation des indépendances.
L’on sait que pour être durable, toute domination doit s’inscrire non seulement sur les corps de ses sujets, mais aussi laisser des marques sur l’espace qu’ils habitent et des traces indélébiles dans leur imaginaire. Elle doit envelopper l’assujetti et le maintenir dans un état plus ou moins permanent de transe, d’intoxication et de convulsion - incapable de réfléchir pour soi, en toute clarté.
L’on comprend que dans ce contexte, les statues et monuments coloniaux n’étaient pas d’abord des artefacts esthétiques destinés à l’embellissement des villes ou du cadre de vie en général. Il s’agissait, de bout en bout, de manifestations de l’arbitraire absolu. Puissances de travestissement, ils étaient l’extension sculpturale d’une forme de terreur raciale. En même temps, ils étaient l’expression spectaculaire du pouvoir de destruction et d’escamotage qui, du début jusqu’à la fin, anima le projet colonial.
Mais surtout il n’y a pas de domination sans une manière de culte des esprits – dans ce cas l’esprit-chien, l’esprit-porc, l’esprit-canaille si caractéristique de tout impérialisme, hier comme aujourd’hui. À son tour, le culte des esprits nécessite, de bout en bout, une manière d’évocation des morts – une nécromancie et une géomancie.
De ce point de vue, les statues et monuments coloniaux appartiennent bel et bien à ce double univers de la nécromancie et de la géomancie. Ils constituent, à proprement parler, des emphases caricaturales de cet esprit-chien, de cet esprit-porc, de cet esprit-canaille qui anima le racisme colonial et le pouvoir du même nom – comme, du reste, tout ce qui vient après : la postcolonie. Ils constituent l’ombre ou le graphe qui découpe son profil dans un espace (l’espace africain) que l’on ne se priva jamais de violer et de mépriser.
Car, à voir ces visages de « la mort sans résurrection », il est facile de comprendre ce que fut le pouvoir colonial - un pouvoir typiquement funéraire tant il avait tendance à réifier la mort des Africains et à dénier à leur vie toute espèce de valeur.
Le rôle des statues et monuments coloniaux est donc de faire re-surgir sur la scène du présent des morts qui, de leur vivant, ont tourmenté, souvent par le glaive, l’existence des Africains. Ces statues fonctionnent à la manière de rites d’évocation de défunts aux yeux desquels notre humanité compta pour rien - raison pour laquelle ils n’avaient aucun scrupule à verser, pour un rien, notre sang, comme du reste on le voit aujourd’hui encore, de la Palestine à l’Iraq en passant par la Tchétchénie et d’autres culs-de-sac de notre planète.
À cause de ces masques de terreur maquillés en visages humains, nous continuons donc de vivre, ici même, chez nous, à l’ombre du racisme colonial dont on sait que l’idée première faisait de nos pays des contrées peuplées par une « sous-humanité ». Ces statues célèbrent, chaque matin de notre vie, le fait que dans la logique coloniale, faire la guerre aux « races inférieures » était nécessaire à l’avancée de la « civilisation ».
Qu’autant de ces monuments soient consacrés à la gloire des soldats et des militaires indique à quel niveau de profondeur gît désormais, dans notre inconscient collectif, l’accoutumance au massacre. Tout y est donc, dans ces monuments de notre défaite : la célébration d’un nationalisme étranger guerrier et conquérant ; celle des valeurs conservatrices héritées des contre-Lumières et qui trouvent un terrain d’expérimentation privilégié dans les colonies ; celle des idéologies inégalitaires nées avec le darwinisme social ; celle de la mort réifiée qui accompagna l’ensemble ; et, aujourd’hui, l’abjection qui, partout nous poursuit, sans repos ni pitié, à l’étranger comme ici même, chez nous.
La réalité est que rien n’a été simple ni univoque dans l’attitude des nationalismes africains postcoloniaux à l’égard des reliques du colonialisme. Trois types de réponses ont vu le jour. Et d’abord, dans la foulée des conflits liés à la décolonisation ou encore à la faveur des bouleversements politiques dont ils ont fait l’expérience dans les années soixante-dix et quatre-vingt notamment, un certain nombre de pays ont cherché à se libérer des symboles de la domination européenne et à imaginer d’autres modes d’organisation de leur espace public. Pour bien marquer leur nouveau statut au sein de l’humanité, ils ont commencé par l’abandon des noms mêmes qui leur furent affublés au moment de la conquête et de l’occupation.
L’affaire du « nom propre »
L’idée était qu’en commençant par le nom, ils redevenaient non seulement propriétaires d’eux-mêmes, mais aussi propriétaires d’un monde dont ils avaient été expropriés. Au passage, ils renouaient les lignes de continuité avec une histoire longue que la parenthèse coloniale avait interrompue.
En octroyant à l’ancienne entité coloniale de la Gold Coast le nouveau prénom de Ghana (ancien empire ouest-africain) ou encore en passant de la Rhodésie au Zimbabwe, voire de la Haute Volta au Burkina Faso, le nationalisme africain cherche, avant tout, à reconquérir des droits sur soi-même et sur le monde et, au passage, à précipiter l’avènement du « dieu » caché en nous.
Mais l’on sait également que ce souci du « nom propre » n’est pas allé sans ambiguïté. Pour des raisons plus ou moins apparentes, le Dahomey (nom d’un ancien royaume esclavagiste de la côte ouest-africaine), par exemple, est devenu le Bénin. D’autres pays ont cherché à redessiner leurs paysages urbains en rebaptisant certaines de leurs villes. Salisbury est devenu Harare au Zimbabwe. Maputo s’est substitué à Lourenço Marques au Mozambique. Léopoldville est devenu Kinshasa. De Fort Lamy, l’on est passé à Ndjamena, tandis que Fort Fourreau est devenu Kousseri, et ainsi de suite.
De manière générale cependant, l’on a conservé les grands repères architecturaux de la période coloniale. Ainsi, l’on peut se promener aujourd’hui sur l’avenue Lumumba à Maputo tout en admirant, dans le même geste, les bâtiments en bordure de l’avenue et qui constituent la parfaite expression de l’Art Déco transplanté dans leur colonie par le Portugal.
La cathédrale catholique est, quant à elle, l’indice même d’une acculturation religieuse qui n’a guère empêché l’émergence d’un syncrétisme culturel des plus marqués. Ainsi, à Maputo par exemple, Karl Marx, Mao Tse Tung, Lénine cohabitent avec Nyerere, Nkrumah, et d’autres prophètes de la libération noire. Si la révocation des signes coloniaux a bel et bien eu lieu, celle-ci a donc toujours été sélective.
Mais c’est dans l’ex-Congo Belge que l’enchâssement des formes coloniales et nationalistes a atteint le plus haut degré d’ambiguïté. Ici, le « nativisme » s’est substitué à la logique raciste tout en récupérant, au passage, les idiomes principaux du discours colonial et en les ordonnant à la même économie symbolique : celle de l’adoration mortifère du potentat – mais cette fois, du potentat postcolonial. D’abord, sous prétexte d’authenticité, le pays a été affublé d’un nouveau nom, le Zaïre. Paradoxalement, les origines de ce nom sont à chercher, non dans quelque tradition ancestrale, mais de la présence portugaise dans la région.
Une autre configuration, mélange de créativité et d’inertie, est l’Afrique du Sud, pays sans doute le plus urbanisé du continent, et où a sévi, jusque très récemment, le dernier racisme d’État au monde, après la Seconde Guerre mondiale. Depuis la fin de la suprématie blanche en 1994, les noms officiels des rivières, des montagnes, des vallées, des bourgades et des grandes métropoles ont peu changé. Il en est de même des places publiques, des boulevards et des avenues.
Aujourd’hui encore, l’on peut rejoindre son lieu de travail en remontant l’avenue Verwoerd (l’architecte de l’apartheid) pour rejoindre son bureau, aller dîner dans un restaurant situé le long du boulevard John Vorster, rouler le long de l’avenue Louis Botha, se rendre à la messe dans une église située à l’angle de deux rues portant, chacune, le nom de quelque lugubre personnage des années de fer du régime raciste.
Montés sur de grands chevaux, l’armée sinistre et rougeoyante des Kruger, Cecil Rhodes, Lord Kitchener, Malan et autres dispose toujours de statues sur les grandes places des grandes villes. Des universités, voire de petites bourgades portent leurs noms. Sur l’une des collines de Pretoria, capitale du pays, trône toujours le Vortrekker Monument, sorte de cénotaphe aussi baroque que grandiose érigé à la gloire du tribalisme Boer et célébrant le mariage de la Bible et du racisme.
Paradoxalement, le maintien de ces vieux repères coloniaux ne signifie pas absence de transformation du paysage symbolique sud-africain. En fait, ce maintien est allé de pair avec l’une des expériences contemporaines les plus frappantes de travail sur la mémoire et la réconciliation.
De tous les pays africains, l’Afrique du Sud est en effet celui où la réflexion la plus systématique sur les rapports entre mémoire et oubli ; vérité, réconciliation avec le passé et réparation a été la plus poussée. L’idée, ici, est non pas de détruire nécessairement les monuments dont la fonction, autrefois, était de diminuer l’humanité des autres, mais d’assumer le passé comme une base pour créer un futur nouveau et différent.
Tel est, au demeurant, le sens des processus de mémorialisation en cours. Ceux-ci se traduisent par l’ensevelissement approprié des ossements de ceux qui ont péri en luttant ; l’érection de stèles funéraires sur les lieux mêmes où ils sont tombés ; la consécration de rituels religieux trado-chrétiens destinés à « guérir » les survivants de la colère et du désir de vengeance ; la création de très nombreux musées (le Musée de l’Apartheid, le Hector Peterson Museum) et de parcs destinés à célébrer une commune humanité (Freedom Park) ; la floraison des arts (musique, fiction, biographies, poésie) ; la promotion de nouvelles formes architecturales (Constitution Hill) et, surtout, les efforts de traduction de l’une des constitutions les plus libérales au monde en acte de vie, dans le quotidien.
L’on aurait pu ajouter, aux figures qui précèdent, celle du Cameroun. Pris dans une commotion orgiaque depuis plus d’un quart de siècle, ce pays représente, pour sa part, l’anti-modèle de la relation d’une communauté avec ses trépassés et notamment ceux dont la mort est la conséquence directe des actes par lesquels ils s’efforçaient de changer l’histoire.
Tel est, par exemple, le cas de Ruben Um Nyobè, Félix Moumié, Ernest Ouandié, Abel Kingue, Osende Afana et plusieurs autres. C’est que, ici, la conscience du temps est le dernier souci de l’État, voire de la société elle-même. Pressés par les impératifs de survie et minés par la corruption et la vénalité, beaucoup, ici, ne voient pas que cette conscience du temps et de l’histoire constitue une caractéristique fondamentale de notre être-humain. Ils ne voient pas qu’un pays qui « s’en fout » de ses morts ne peut pas nourrir une politique de la vie. Il ne peut promouvoir qu’une vie mutilée – une vie en sursis.
Penser et lutter
La question, aujourd’hui, est de savoir préciser les lieux depuis lesquels il est encore possible de penser et de lutter. Comme on le voit en Afrique du Sud, ceci commence par une méditation sur la manière de transformer en présence intérieure l’absence physique de ceux qui ont été perdus, rendus à la poussière par le soleil du langage. Il nous faut donc méditer sur cette absence et donner, ce faisant, toute sa force au thème du sépulcre, c’est-à-dire du supplément de vie nécessaire au relèvement des morts, au sein d’une culture neuve qui ne doit plus jamais oublier les vaincus.
À cause de notre situation actuelle, une très grande partie de cette lutte porte, de nécessité, sur la critique de l’ordre général des significations dominantes dans nos sociétés. Car, face au désœuvrement, il est facile de disqualifier ceux qui s’acharnent à penser de manière critique les conditions de réalisation de l’existence africaine, sous le prétexte qu’il faut en priorité nourrir les affamés et soigner les malades.
L’accouchement d’une nouvelle conscience dépendra en effet de notre capacité à produire chaque fois de nouvelles significations. Il faut donc reprendre, comme tâche centrale d’une pensée toujours ouverte sur l’avenir, la question des valeurs non mesurables, de la valeur absolue – celle qui ne peut jamais être réduite à l’équivalent général qu’est l’argent ou la force pure.
Car ce que, paradoxalement, nous enseignent la colonisation et ses reliques, c’est que l’humanité de l’homme n’est pas donnée. Elle se crée. Et il ne faut rien céder sur la dénonciation de la domination et de l’injustice, surtout lorsque celle-ci est désormais perpétrée par soi-même – à l’ère du fratricide, c’est-à-dire cette époque où le potentat postcolonial n’a rien à proposer d’autre que l’évidence nue d’une existence dénudée. L’enjeu symbolique et politique de la présence des statues et monuments coloniaux sur les places publiques africaines ne peut donc être sous-estimé.
Que faire, finalement ? Je propose que dans chaque pays africain, l’on procède immédiatement à une collecte aussi minutieuse que possible des statues et monuments coloniaux. Qu’on les rassemble tous dans un parc unique, qui servira en même temps de musée pour les générations à venir. Ce parc-musée panafricain servira de sépulture symbolique au colonialisme sur ce continent.
Une fois cet ensevelissement effectué, qu’il ne nous soit plus jamais permis d’utiliser la colonisation comme prétexte de nos malheurs dans le présent. Dans la foulée, que l’on se promette de ne plus jamais ériger de statues à qui que ce soit. Et qu’au contraire, fleurissent partout bibliothèques, théâtres, ateliers culturels – tout ce qui nourrira, dès à présent, la créativité culturelle de demain.
© Le Messager 2006
* Veuillez envoyer vos commentaires à
*Achille Mbembe est historian et il est actuellement Chercheur au Wits Institute for Social & Economic Research (WISER) (Afrique du Sud).