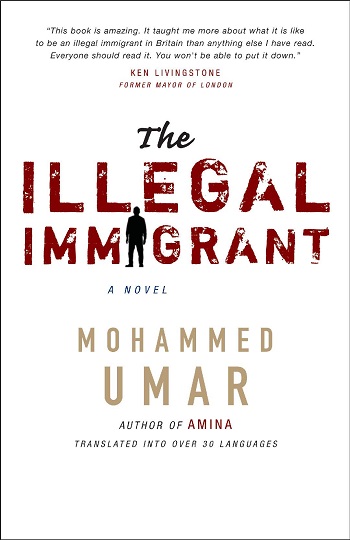Les crises multiformes qui se sont exacerbées à travers le monde, au cours de ces deux dernières années, ont fait l’objet d’analyses et de propositions diverses en matière de solution. Le plus souvent sous la perspective d’un Nord dominant dont le système s’effondre, et qui s’accroche encore à des certitudes que Samir Amin perçoit comme des préjugés erronés. Moins que des solutions, ce qui est avancé lui apparaît plutôt comme « le produit de stratégies du capital des oligopoles, organisant les conditions qui lui sont favorables». Sans aucune perspective de décision autonome pour les pays du Sud.
On peut lire ce que sont les réponses des pouvoirs dominants (les oligopoles et leurs serviteurs politiques) à la « crise » ouverte par l’effondrement financier de 2008, à partir des politiques nationales effectives des pays de la Triade et des décisions collectives du G7 et de l’Union Européenne. Le rapport de la commission présidée par J. Stiglitz, présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies réunie du 24 au 26 juin 2009 complète cet ensemble de documents. Leur objectif est de restaurer le système de la mondialisation libérale financiarisée, considéré comme ayant été globalement sain, dès lors que des mesures correctives sont adoptées permettant d'éviter à l'avenir les dérapages qui auraient été à l'origine de l'effondrement de 2008,et guère plus. Cet objectif enferme dans l’ensemble des préjugés propres à l’économie conventionnelle.
Premier préjugé
La crise est une crise financière, produite par des « excès » d’expansion financière (eux-mêmes facilités par des « dérèglementations » abusives). Il ne s’agit là que d’une évidence triviale immédiate. Car derrière les excès en question se profilent les exigences incontournables du déploiement de la logique d’expansion des oligopoles. Les économistes conventionnels n’ont pas l’équipement intellectuel permettant de le comprendre. Et, l’effondrement financier de 2008, qui était la conséquence inéluctable du déploiement de la longue crise amorcée dès les années 1970, et pas seulement des excès financiers des dernières années, a donc surpris tous les économistes vulgaires.
La crise en cours serait donc une crise conjoncturelle, même si on accepte qu’elle soit accompagnée de « problèmes structurels » sous-jacents particuliers, une crise en V, dont la reprise rapide est possible. La croissance qui doit reprendre restera dynamisée par l’expansion financière, comme elle l’était avant l’effondrement de 2008. Les seules précautions à prendre sont destinées à éviter à l’avenir les dérives de cette expansion. Dans sa dimension mondialisée, le système doit reprendre sa croissance dans le même cadre libéral « ouvert » qui le caractérise depuis trois décennies, et éviter les réponses « protectionnistes » aux difficultés du moment. Proches de la vision de la CIA exprimée dans son rapport « Le monde en 2010 », dont j’ai proposé une lecture critique ailleurs (15), ces analyses conventionnelles n’envisagent pas de « bouleversements », mais seulement un poids commercial plus important de la Chine et des autres pays émergents. Cette évolution pourrait être facilitée par l’abandon progressif de la référence exclusive au dollar comme monnaie de réserve internationale. La réforme du système devrait se donner cet objectif.
En conséquence, pour sortir de la crise, il suffit que l’on donne la priorité au rétablissement du fonctionnement du système financier. Des réformes de celui-ci doivent être envisagées, capables, selon les experts du G7, d’éviter la rechute. Ces experts ne sont pas équipés pour comprendre que ces réformes seront d’une manière ou d’une autre contournées par les pratiques des oligopoles tant que ceux-ci conserveront leur statut « privé » garantissant leur gestion au service exclusif des intérêts particuliers qu’ils concentrent dans leur pouvoir. Le discours « moralisant » et la substitution du sermon à l’analyse politique resteront comme toujours sans efficacité.
Deuxième préjugé
L’identification des moyens capables de protéger efficacement le système économique et financier des dérives et des « crises » peut être découverte par l’approfondissement des recherches concernant le fonctionnement effectif des marchés. La profession des économistes conventionnels s’est constituée sur la base presqu'exclusive de ce type de recherches. L’hypothèse sous jacente est que les marchés sont auto régulés par eux-mêmes (point de vue libéral dogmatique), ou qu'on peut les aider à le devenir par des régulations appropriées. Et bien que la preuve de l’existence d’une telle tendance fondamentale ou de sa possibilité n’ait jamais pu être établie, la profession des économistes vulgaires est contrainte de croire à cet axiome erroné. Car si les marchés ne sont pas auto régulés et même auto régulables dans le capitalisme, les économistes conventionnels n'ont plus rien à dire, ils doivent fermer leur boutique!
Dans le capitalisme réel, le fonctionnement du système et des marchés, l’intervention des luttes sociales et des conflits internationaux et les régulations elles-mêmes interagissent pour faire évoluer le système de déséquilibre en déséquilibre (à la rigueur en passant par un équilibre provisoire). L’action des acteurs qui veulent promouvoir les intérêts des travailleurs et des peuples s’inscrit dans cette perspective, refuse de se soumettre aux exigences d’un prétendu « équilibre » (ou équilibre apparent) qui les défavorise pour imposer un autre « équilibre » (ou déséquilibre) meilleur pour eux. Cette option fondamentale de méthode devrait être celle de notre projet alternatif.
Troisième préjugé
La restauration du système de la mondialisation telle qu’elle était pour l’essentiel est souhaitable, car elle offre des possibilités de développement pour les peuples du Sud. Ce préjugé, commun à tous les économistes vulgaires, qui partagent la vision linéaire simpliste à l’extrême du « développement par étapes » (à la Rostow), interdit aux économistes conventionnels de comprendre la nature de l’échec historique permanent du « Sud » (les périphéries) dans ses efforts de « rattrapage » du « Nord » (le centre) par son insertion approfondie dans la mondialisation capitaliste. L’idée que l’accumulation capitaliste mondialisée est à l’origine de la production et de la reproduction de l’échec en question leur est totalement étrangère au point d’être véritablement incompréhensible. (1)
C’est pourquoi les économistes conventionnels sont contraints d’ignorer la paupérisation inhérente à la poursuite de cette accumulation mondialisée pour lui substituer des considérations sur un phénomène considéré alors comme seulement adjacent – « la pauvreté » - dont la réalité est rapportée à des « fautes » de politique, qu’on peut corriger sans poser la question de la logique du procès d’accumulation. Néanmoins la tentative de formuler des programmes de « réduction de la pauvreté » n’a jamais donné que de minces résultats. Les résistances, révoltes et éventuellement engagements des sociétés du Sud dans d’autres voies paraissent alors, à ces économistes, « irrationnelles », motivées par des options « idéologiques » creuses (du type « nationalisme outrancier » etc.). On écarte donc du champ de la réflexion la prise en considération de ces résistances et engagements alternatifs, qui, pourtant, sont appelés à occuper le devant de la scène.
Quatrième préjugé
Les problèmes graves auxquels l’humanité contemporaine est confrontée (des modes de production trop énergétivores, l’épuisement de certaines ressources naturelles, les déficiences des systèmes de production alimentaires et autres) constitueraient des problèmes adjacents, séparés les uns des autres ; indépendants du système saisi dans sa totalité. Des solutions pourraient donc leur être trouvées dans le système tel qu’il est pour l’essentiel.
La profession des économistes vulgaires ignore les questions de l’écologie, situées hors de son champ de réflexion, contrairement à Marx qui distinguait valeur et richesse. Les nouveaux « écolo-économistes » tentent d’associer la prise en compte de ces questions et les méthodes de calculs héritées de l’économie conventionnelle. Une conciliation impossible, mais qui, néanmoins, permet à tous les hommes (et femmes) des pouvoirs (de droite et de gauche) et des dirigeants des oligopoles de s’habiller à bon marché de la couleur verte est désormais à la mode comme on l’a dit plus haut.
En fait les « problèmes structurels » considérés dans les analyses proposées par les économistes vulgaires excluent les trois grandes familles de questions qui définissent le défi majeur auquel le système contemporain est confronté.
La première de ces familles concerne l’organisation de la production et du travail. On ne fait que rarement une simple allusion à la « crise (fin) du fordisme » par exemple qui est pourtant à l’origine de la crise longue depuis trois décennies et sans la considération de laquelle la faillite de l’industrie automobile – entre autre – reste sans explication. Ignorer la crise structurelle de l’accumulation fordiste c’est se condamner à ne pas comprendre comment celle-ci créait les conditions d’une offensive contre le travail et pourquoi la financiarisation en a été précisément le moyen. Mais comme on l’a déjà les économistes orthodoxes libéraux ne sont pas équipés pour intégrer ces questions dans leur « économique des marchés ».
La seconde famille des questions ignorées concerne le statut et la gestion des entreprises (du capital). L’existence même des groupes oligopolistiques n’est prise en considération qu’à travers des propos insignifiants invitant à la « révision de la gouvernance d’entreprise » ! Pourtant, face aux positions libérales orthodoxes de droite (en fait tout à fait réactionnaires), un large éventail de l’opinion publique est déjà conscient de la nécessité de remettre en question la gestion privative de ces groupes. J’en donne l’exemple de la profession des médecins qui, dans son ensemble, conçoit sans difficulté la nécessité de soumettre la gestion des industries pharmaceutiques aux impératifs de la satisfaction des besoins sociaux, voire pour le faire de les nationaliser.
La troisième série de « grandes » questions concerne évidemment les distances qui séparent, dans le système mondialisé, les « pays développés » (le Nord) de ceux « en voie de développement » (le Sud). Dans un rapport de l’ONU comme dans un rapport quelconque se situant dans le cadre de considérations sur la mondialisation cette distinction ne peut pas être « oubliée ». Mais les économistes du système ne sortent jamais de la vision simpliste du « développement par étapes » (Rostow) du libéralisme orthodoxe qui, en fait, ignore la question.
Le G7 s’est proposé – dans les limites de sa méthode indiquées plus haut – « une sortie par le haut » de la crise. Il a donc réuni une somme de propositions qu’il juge suffisantes et efficaces pour permettre à un système de la mondialisation « corrigé » d’associer ce qu’il prétend être les avantages décisifs du capitalisme mondialisé (permettre le développement de tous les pays Nord et Sud) et les « remèdes » nécessaires et suffisants selon lui pour en corriger les défauts et les erreurs (réduction des risques financiers, « gouvernance » démocratique des institutions internationales, réduction de la pauvreté, prise en compte – légère pour ne pas dire insignifiante – de « questions adjacentes », amorce timide – peut être - d’un système financier sorti de sa référence exclusive au dollar).
Dans ces analyses, aucune perspective de décision autonome pour les pays du Sud n’est prise en considération. L’idée même de cette autonomie est parfaitement étrangère au concept orthodoxe libéral de la « mondialisation ». L'argument avancé pour faire accepter l'idée qu'un consensus global serait incontournable est simpliste : la crise est globale, donc sa solution doit l'être! On passe sous silence le fait que derrière ce consensus d'apparence le Nord s'emploie à imposer ses vues unilatérales. En réalité la reconstruction d'une mondialisation utile aux peuples passe par la déconstruction préalable de la mondialisation des oligopoles.
Sans doute fait-on la concession apparente de la nécessité du « traitement différencié des pays développés et des pays en voie de développement » et invite-t-on les premiers à « ouvrir leurs marchés aux exportations du Sud ». En fait, cette concession se résume dans l’esprit de sa formulation à l’octroi de quelques années « de traitement de faveur », puisqu’on souhaite ouvertement la conclusion du cycle de Doha qui ne prévoit rien de plus. On affiche une ignorance totale et sans doute méprisante à l’égard des critiques sévères et justifiées à l’endroit de l’OMC, pour lesquelles nous renvoyons le lecteur aux analyses dévastatrices de Jacques Berthelot et de Via Campesina, concernant le traitement des productions agricoles et alimentaires. (2) On ne signale même pas les contre propositions faites par des groupes de pays du Sud. Au demeurant l’insistance sur l’ouverture du Nord aux exportations du Sud, conçue comme la voie royale de développement par l’orthodoxie libérale, élimine d’emblée l’examen d’une autre voie, fondée sur la priorité donnée à l’élargissement du marché interne des pays du Sud (individuellement et collectivement) et sur la réduction relative de leurs exportations vers le Nord.
La question grave de la dette extérieure de certains pays du Sud ne donne lieu qu’à des propositions de « moratoire quand la dette est trop lourde». L’examen des analyses de la dette qui ont établi son caractère spoliateur, souvent immoral, et la revendication d’un audit de cette dette et de l’élaboration d’un droit international digne de ce nom dans ce domaine sont également parfaitement ignorés.
Quelques propositions « nouvelles » concernant le FMI peuvent donner l’illusion qu’on se propose de faire davantage. Par exemple proposition « d’achever l’émission de DTS approuvé par le FMI (en 1997 !) ». Mais celle-ci ignore que, par les règles qui gouvernent cette émission, ce sont les pays les plus riches (en particulier ceux du Nord) qui en seront les bénéficiaires majeurs, tandis que les montants qui pourraient faciliter les règlements des pays pauvres du Sud demeurent insignifiants. D’une manière générale, on ne remet pas en cause les principes fondamentaux qui régissent la conditionnalité associée aux interventions du FMI quand bien même signale-t-il la nécessité d’atténuer leurs effets « pro-cycliques ». Le FMI reste ce qu’il est : l’autorité de gestion coloniale des monnaies des pays du Sud, auxquels s’ajoutent désormais ceux de l’Europe de l’Est. Les interventions récentes du FMI en Hongrie et en Lettonie en illustrent la réalité.
On reconnaît parfois, à la limite, le droit légitime des pays du Sud à gérer leur compte capital, voire à « contrôler les flux financiers ». L’invitation faite à donner la priorité à la législation (libérale quand même, bien entendu) du pays hôte plutôt qu’à celle du pays d’origine des institutions bancaires s’aligne sur ces concessions. Mais on pourrait faire observer que sur ces points on ne fait qu’inviter le FMI à retourner aux principes qui furent les siens et n’ont été abandonnés, tard dans les années 1990, que sous la pression des libéraux dogmatiques extrémistes. Comme on pourrait observer que la résistance de la Chine, qui refuse toujours la libération financière mondialisée, est pour quelque chose dans cette rare note de réalisme politique.
D’une manière générale, on reste sur les positions de l’orthodoxie libérale extrême qui refuse de remettre en question le principe des changes flexibles, de la détermination des taux d'intérêt par le "marché" (c'est-à-dire en fait par le capital financiarisé), voire de la préférence pour la comptabilité "aux prix du marché" (générale chez tous les économistes anglo saxons, Stiglitz inclus). Dans ces conditions il est douteux que la proposition « d’élargissement des DTS » – ouvre la voie à la substitution d’un instrument de réserve international « nouveau », différent de celui en place fondé sur l’usage dominant d’une monnaie nationale (en l’occurrence le dollar) comme monnaie de réserve internationale. Les autorités chinoises, elles, ont effectivement amorcé une évolution dans cette direction par des accords passés avec quelques partenaires du Sud. Et même si, dans l’état actuel, ces accords ne concernent qu’une fraction minime du commerce de la Chine (5 %), ils n’en demeurent pas moins l’exemple de ce que le Sud peut faire, sans chercher à obtenir un « consensus global » (c'est-à-dire l’approbation du Nord) qui l’y autorise. Les accords de l’ALBA et de la Banco Sur s’inscrivent dans cet esprit, bien qu’ils n’aient pas encore donné lieu à une mise en œuvre effective importante.
Finalement la proposition de mettre en place un « Conseil de Sécurité Economique » (le « Conseil Mondial de Coordination Economique ») demeure dans ces conditions ambigüe. S’agit-il de dresser un obstacle supplémentaire aux droits légitimes des pays du Sud de décider par eux-mêmes des formes de leur participation à la mondialisation, en imposant le « consensus global » ? On peut le soupçonner. Comme on peut soupçonner que si, par hasard (par malheur pour les économistes libéraux) les pays du Sud tentaient de mettre l’institution au service de leur propre concept du développement, ne verrait-on pas ceux du Nord en marginaliser le rôle, comme ils l’ont fait avec l’ONU, la CNUCED, le Conseil Economique et Social et bien d’autres institutions quand elles échappent à leur contrôle unilatéral ?
Ce projet est tout à fait irréaliste. Il l’est d’abord parce que l’idée même que le système restauré dans ce qu’il a d’essentiel atténuera le conflit Nord-Sud reste sans fondement. Cette idée est déjà démentie dans les faits. Il l’est aussi parce que les propositions qu’on suggère d’adopter ne peuvent être mises en œuvre que si les oligopoles le veulent bien. L’inverse est plus probable. Je crois cette volonté de proclamer possible la « sortie par le haut » n’est pas seulement irréaliste, mais de surcroît dangereuse par les illusions qu’elle inspire.
L’analogie est forte entre le modèle « de sortie par le haut dans le capitalisme» proposée par les économistes conventionnels et celui de « sortie par le haut par la révolution socialiste » proposée par d’autres. Il s’agit dans les deux cas du « grand soir », au lendemain duquel tous les problèmes sont réglés. L’histoire ne fonctionne pas de cette manière. L’histoire avancera à tâtons par les réponses données aux défis immédiats, à travers principalement les conflits internationaux Nord-Sud. Sans négliger pour autant les réponses – toujours partielles – que le déploiement des luttes sociales dans le Nord et le Sud apporteront à ces défis. L’interaction des unes et des autres engagera l’humanité soit sur la longue route du progrès (et pour moi celle-ci deviendra celle de la transition socialiste) soit sur celle de la barbarie. Proposer une « sortie par en haut dans le capitalisme » n’évite pas l’engagement sur la route du désastre. Appeler dans des formes de gesticulation révolutionnaire au « grand soir » de la Révolution (R majuscule) socialiste restera, d’évidence, sans effet.
La lecture du chapitre 2 de l’excellent ouvrage rédigé par Jean Marie Harribey et Dominique Plihou pour ATTAC - Sortir de la Crise Globale ; La Découverte 2009 - (3) permet de mesurer l’ampleur du désastre que représente le point de vue réactionnaire du G7 tant au plan social qu’à celui du type de relations internationales qu’il implique. Ces auteurs écrivent (p. 35) : « La financiarisation n’est pas un facteur autonome, elle apparaît comme la contrepartie logique de la baisse de la part salariale et de la raréfaction des occasions d’investissement suffisamment rentables. C’est pourquoi la montée des inégalités sociales (à l’intérieur de chaque pays et entre zones de l’économie mondiale) est un trait constitutif du fonctionnement du capitalisme contemporain ».
Or l’objectif des pouvoirs en place n’est autre que précisément de remettre en marche ce système, et de restituer à la financiarisation les fonctions décrites par ATTAC. On accepte le choix d’une société de plus en plus inégalitaire, aux plans nationaux et au plan mondial, annihilant par là même les belles phrases concernant la « réduction de la pauvreté ».
Ce choix est celui de l’establishment des Etats Unis dans son ensemble, et de ses fidèles défenseurs. Car en effet le modèle en question (« inégalités sociales et internationales associées à la financiarisation ») est le seul qui permette aux Etats Unis de maintenir leur position hégémonique. D’une double manière. D’une par ce qu’il permet de substituer à la carence de la demande associée à la surexploitation du travail une dynamisation par l’endettement. Et d’autre part parce qu’il permet de financer le déficit extérieur des Etats Unis par son ouverture à la mondialisation financière. Comme l’écrivent les auteurs de l’ouvrage d’ATTAC : « la règlementation de la finance est un remède nécessaire, mais qui ne peut suffire … La financiarisation se nourrit de la baisse de la part salariale et des déséquilibres de l’économie mondiale. Pour dégonfler la finance, il faudrait donc fermer ces deux robinets … ce qui implique une autre répartition des richesses et une autre organisation de l’économie mondiale » (p. 41).
Or précisément ni les Etats Unis, ni leurs alliés subalternes européens n’acceptent la fermeture de ces robinets. Car la fermeture du robinet qui, par le canal du déficit extérieur des Etats Unis, alimente l’expansion du marché financier importerait la crise sociale mondiale aux Etats Unis même. C’est pourquoi la crise est, comme je l’analyse, une crise double, à la fois du capitalisme tardif des oligopoles et de l’hégémonie des Etats Unis, ces deux dimensions de son déploiement étant indissociables. Les hypothèses retenues par les économistes du système sont, de ce fait, irréalistes et, dans un horizon temporel bref ou moins bref, seront remises en question par la reconquête de l’autonomie de décision des pays du Sud qui en sont les victimes majeures.
Le modèle réactionnaire de « sortie par le haut » de la crise « financière » et de double restauration de la domination mondiale brutale des oligopoles et de l’hégémonie des Etats Unis préconisé n’est certainement pas le seul possible. Il est même probablement le moins réaliste, même s’il répond au souhait des administrations successives de Washington et, par la force des choses, des gouvernements subalternisés de l’Europe atlantiste.
Il existe une autre famille de propositions de « sortie par la haut », préconisées par d’autres économistes tout également conventionnels mais néanmoins préoccupés de mettre en œuvre un plan de réformes conséquent du capitalisme mondial. Qu’on les qualifie de « keynésiens », ou de « néo-keynésiens », ou autrement importe peu.
Les inégalités sociales croissantes ne sont alors pas acceptées comme « le prix fatal nécessaire du progrès », mais au contraire analysées comme le produit de stratégies du capital des oligopoles, organisant les conditions qui lui sont favorables (la fragmentation du travail et la mise en concurrence internationale des travailleurs). Ces stratégies sont à l’origine de la longue crise de l’accumulation qu’elles perpétuent. La crise en cours n’est donc pas une crise conjoncturelle en V mais une crise longue en L. Un grand plan de relance axé sur la réduction des inégalités pourrait alors transformer le L en U.
Le plan est audacieux, il doit l’être. (4) La nationalisation (point de départ d’une socialisation possible) n’est pas exclue (en particulier pour les institutions financières). La stabilisation des prix des valeurs mobilières autour de 50 % des prix artificiels et fabuleux que la financiarisation avait permis n’est pas considéré comme un désastre, mais au contraire comme une opération de purge saine. Faire reculer la marchandisation des services sociaux (éducation, santé, logement, transports publics, sécurité sociale et retraites) est conçu alors comme nécessaire et obligatoire. Un accroissement massif et durable de l’intervention publique, voire – pour le moyen terme des années à venir permettant la transformation du L en U – un accroissement des déficits publics enregistrés (ce qui vaut à ce plan la qualification de « keynésien »), n’est pas davantage considéré comme catastrophique. La « reprise » concerne alors en priorité l’économie productive, marginalisant l’impact des marchés financiers.
Le plan est voulu mondial, mais s’inscrit dans la perspective d’une mondialisation négociée, permettant aux différents pays et régions de la planète (Europe inclus) de favoriser en priorité leurs marchés internes et régionaux. Des stratégies de soutien systématique aux économies paysannes deviennent alors possibles et constituent la bonne réponse à la crise alimentaire. Les défis écologiques peuvent alors tout également être traités sérieusement, et non plus contournés par les oligopoles. Le plan mondial comporte son volet politique, qui s’ouvre par le renforcement des institutions et du droit internationaux. Il s’inscrit dans la vision d’une « mondialisation sans hégémonie », ni celle unilatérale des Etats-Unis, ni celle collective de la triade.
Néanmoins l’erreur grave serait de rechercher le « consensus global » pour la mise en œuvre d'une sortie de la crise par le haut. Car dans l’état actuel des choses un consensus authentique est impossible et la poursuite de cette chimère revient à s’aligner sur le G 7 réactionnaire, se substituant, comme le langage de tous les jours l’illustre, à « la communauté internationale ».
Mais si les choses sont ainsi cela signifie que le chaos du système mondial n’est pas en voie d’être dépassé. Au contraire, le monde est engagé sur le chemin d’un chaos toujours grandissant. La meilleure réponse alternative passe par le renforcement des chances d’une reconquête de l’autonomie du Sud, sans, pour le moment, chercher à convaincre le Nord par un faux « consensus ».
C’est donc une toute autre méthode que je proposerai pour avancer dans des réponses possibles (« réalistes ») et efficaces s’inscrivant sur la route du progrès. Sans doute la conviction socialiste de certains (dont moi-même) n’est-elle pas l’objet de notre discussion ici. Dans mon livre « Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise » j’exprime mon point de vue (et sans doute celui d’autres), mais n’en fait pas la « frontière » (5) qui nous séparerait des alliés dans nos luttes communes.
L’alternative consistera à donner la possibilité aux pays du Sud non pas de polémiquer contre le Nord mais d’avancer ensemble de leur côté, loin de la recherche d’une solution « de consensus global » acceptable par le Nord. Tel est l’objectif de notre proposition alternative.
Pour un projet alternatif de réponse du Sud à la crise
Les pays du Sud peuvent faire avancer leurs réponses à la crise par leurs propres moyens, sans s’inquiéter trop des réactions du Nord aux mesures qu’ils seront amenés à prendre soit à leurs niveaux nationaux, soit autant que possible à ceux de leurs regroupement régionaux (existants et à venir) et à leur niveau global (le « Bandung 2 », ou mieux la « Tricontinentale 2 »).
L’objet d'un rapport alternatif sera de formuler d’une manière précise des propositions allant dans ce sens. Il existe fort heureusement un bon nombre d’études critiques de grande qualité qui constituent un excellent stock de références de départ pour cet exercice. Je citerai entre autres le rapport récent de la CNUCED en avril 2009 (7), largement supérieur aux rapports du G7 et à celui de la commission présidée par Stiglitz, les travaux de Jacques Berthelot et ceux de Via Campesina, beaucoup des documents discutés à l’Assemblée du Forum Mondial des Alternatives d’Octobre 2008, ou produits à sa suite.
Ces propositions s’inscrivent dans l’idée de fond et de base que dans un horizon stratégique possible et visible le « Sud » peut se passer du « Nord », tandis que l’inverse n’est pas vrai. Le Nord – tel qu’il est (et il n’imagine pas d’alternative) – ne peut pas survivre sans renforcer le pillage des ressources du Sud – ressources naturelles, pétrole et gaz, produits miniers, sols agricoles, main d’œuvre à bon marché. Donc aggraver et non atténuer le développement inégal, annihiler les espoirs des pays « émergents », détruire encore davantage les pays "marginalisés".
Le Sud est désormais équipé pour réduire l’efficacité des moyens par lesquels le Nord exerce sa domination, voire en annihiler la portée. Il peut récupérer le contrôle de ses ressources naturelles, développer par lui-même les technologies les plus avancées et les mettre au service de son développement, il peut organiser ses rapports financiers à côté sinon tout à fait hors du système global, il peut réduire la menace d’agressions militaires, qui constitue en dernier ressort le seul moyen – barbare et criminel – de le maintenir dans la dépendance. Celle-ci peut paraître pesante à court terme. Mais une stratégie de développement renforcée par l’intensification des formes adéquates de coopérations Sud - Sud peut en réduire progressivement – et même rapidement – les effets destructeurs.
L’économie est toujours politique. Et la politique est toujours nationale et internationale. Au premier de ces plans le rapport devra donc considérer (pour être sérieux) l’articulation entre les conflits d’intérêts sociaux au sein des sociétés du Sud et la formulation des alternatives de développement. Au second de ces plans il devra prendre en compte les exigences de la construction de convergences politiques communes obligeant la triade à reculer, voire à renoncer à son projet de guerre permanente pour le contrôle militaire de la Planète.
Les formes et étapes de la réalisation de ce projet restent encore à discuter.
- Le FMA et le FTM doivent être les initiateurs du projet et mettre en place à cet effet une commission chargée de rédiger le rapport (un an, une vingtaine de membres soigneusement choisis ?)
- Le rapport final de cette commission doit être largement diffusé auprès des forces politiques intéressées et porté à la connaissance des gouvernements du Sud.
- Dans l’hypothèse de succès de l’entreprise on pourrait imaginer une suite donnée au projet par la constitution d’un groupe « officiel », opérant par exemple dans le cadre du Secrétariat du NAM (Mouvement des Non Alignés) ou du groupe 77 + Chine de l’ONU. Il serait souhaitable que la Présidence du groupe soit confiée à une personnalité politique respectée, comme par exemple Nelson Mandela.
NOTES
1) Je fais ici référence à l'ouvrage "classique" de Rostov (Les étapes de la croissance, 1960).. Ma thèse sur l'accumulation à l'échelle mondiale (première rédaction,1957) s'inscrivait avant la lettre contre la vision linéaire de Rostov.
2) Jacques Berthelot, contributions diverses, sites web de l'auteur
Via Campesina, publications diverses
3) Sortir de la crise globale, ed Jean Marie Harribey et Dominique Plihon; La découverte
4) Le cercle des économistes, Fin de monde ou sortie de la crise, ed Pierre Dockès; Perin 2009.
5) Christian Saint Etienne, La fin de l'euro; Ed Bourin, 2009
6) Samir Amin, Sur la crise, sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise; Le Temps des Cerises 2009
7) CNUCED, Avril 2009, site de l'organisation
* Samir Amir est le directeur du Forum du Tiers Monde
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 1103 lectures