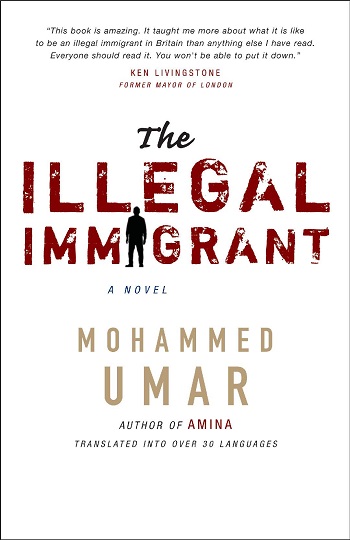Dans la première partie de ce texte, publié dans notre dernière édition, Samir Amin montre comme les questions de démocratie et d’environnement structurent le discours actuel de domination des pays du Sud par le Nord. Pour ensuite affirmer que le progrès démocratique ne peut se concevoir hors de la perspective socialiste, tout comme il pense que le socialisme ne peut se construire sans démocratie. Dans cette seconde partie, M. Amin soutient qu’une deuxième vague de luttes pour le socialisme s’impose, inspirée de celle du XXe siècle mais dont elle doit tirer leçon des limites et des erreurs.
Le monde contemporain est gouverné par des oligarchies. Oligarchies financières aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, qui dominent non seulement la vie économique, mais tout autant la politique et la vie quotidienne. Oligarchies russes à leur image que l’Etat russe tente de contrôler. Statocratie en Chine. Autocraties (parfois cachées derrière quelques apparences d’une démocratie électorale « de basse intensité ») inscrites dans ce système mondial ailleurs dans le reste de la planète.
La gestion de la mondialisation contemporaine par ces oligarchies est en crise.
Les oligarchies du Nord comptent bien rester au pouvoir, le temps de la crise passé. Elles ne se sentent pas menacées. Par contre la fragilité des pouvoirs des autocraties du Sud est, elle, bien visible. La mondialisation en place est, de ce fait, fragile. Sera-t-elle remise en question par la révolte du Sud, comme ce fut le cas au siècle passé ? Probable. Mais insuffisant. Car l’humanité se s’engagera sur la voie du socialisme, seule alternative humaine au chaos, que lorsque les pouvoirs des oligarchies, de leurs alliés et de leurs serviteurs seront mis en déroute à la fois dans les pays du Nord et dans ceux du Sud.
Le capitalisme est « libéral » par nature, si l’on entend par « libéralisme » non pas ce joli qualificatif que le terme inspire, mais l’exercice plein et entier de la domination du capital non pas seulement sur le travail et l’économie, mais sur tous les aspects de la vie sociale. Il n’y a pas « d’économie de marché » (expression vulgaire pour dire capitalisme) sans « société de marché ». Le capital poursuit obstinément cet objectif unique. L’Argent. L’accumulation pour elle-même. Marx, mais après lui d’autres penseurs critiques comme Keynes, l’ont parfaitement compris. Pas nos économistes conventionnels, ceux de gauche inclus.
Ce modèle de domination exclusive et totale du capital avait été imposé avec obstination par les classes dirigeantes tout au long de la longue crise précédente jusqu’en 1945. Seule la triple victoire de la démocratie, du socialisme et de la libération nationale des peuples avait permis, de 1945 à 1980, la substitution à ce modèle permanent de l’idéal capitaliste, de la coexistence conflictuelle des trois modèles sociaux régulés qu’ont été le Welfare State de la social démocratie à l’Ouest, les socialismes réellement existants à l’Est et les nationalismes populaires au Sud. L’essoufflement puis l’effondrement de ces trois modèles a par la suite rendu possible un retour à la domination exclusive du capital, qualifiée de néo libérale.
Les désastres sociaux que le déploiement du libéralisme – « l’utopie permanente du capital » ais-je écrit – n’allait pas manquer de provoquer ont inspiré bien des nostalgies du passé récent ou lointain. Mais ces nostalgies ne permettent pas de répondre au défi. Car elles sont le produit d’un appauvrissement de la pensée critique théorique qui s’était progressivement interdit de comprendre les contradictions internes et les limites des systèmes de l’après seconde guerre mondiale, dont les érosions, les dérives et les effondrements sont apparus comme des cataclysmes imprévus.
Néanmoins, dans le vide créé par ces reculs de la pensée théorique critique, une prise de conscience de dimensions nouvelles de la crise systémique de civilisation a trouvé le moyen de se frayer la voie. Je fais référence ici aux écologistes. Mais les Verts, qui ont prétendu se distinguer, radicalement et tout également, des Bleus (les conservateurs et les libéraux) et des Rouges (les Socialistes) se sont enfermés dans l’impasse, faute d’intégrer la dimension écologique du défi dans une critique radicale du capitalisme.
Tout était en place donc pour assurer le triomphe – passager en fait, mais qui s’est vécu comme « définitif » - de l’alternative dite de la « démocratie libérale ». Une pensée misérable – une véritable non pensée – qui ignore ce que pourtant Marx avait dit de décisif concernant cette démocratie bourgeoise qui ignore que ceux qui décident ne sont pas ceux qui sont concernés par ces décisions. Ceux qui décident, jouissent de la liberté renforcée par le contrôle de la propriété, sont aujourd’hui les ploutocrates du capitalisme des oligopoles et les Etats qui sont leurs débiteurs. Par la force des choses, les travailleurs et les peuples concernés ne sont guère que leurs victimes. Mais de telles billevesées pouvaient paraître crédibles, un court moment, du fait des dérives des systèmes de l’après-guerre, dont la misère des dogmatiques ne parvenait plus à comprendre les origines. La démocratie libérale pouvait alors paraître le « meilleur des systèmes possibles ».
Aujourd’hui les pouvoirs en place, qui eux n’avaient rien prévu, s’emploient à restaurer ce même système. Leur succès éventuel, comme celui des conservateurs des années 1920 – que Keynes dénonçait sans trouver d’écho à l’époque – ne pourra qu’aggraver l’ampleur des contradictions qui sont à l’origine de l’effondrement financier de 2008.
La récente réunion du G20 (Londres, avril 2009) n’amorce en rien une « reconstruction du monde ». Et ce n’est peut être pas un hasard si elle a été suivie dans la foulée par celle de l’OTAN, le bras armé de l’impérialisme contemporain, et par le renforcement de son engagement militaire en Afghanistan. La guerre permanente du « Nord » contre le « Sud » doit continuer.
On savait déjà que les gouvernements de la triade (Etats Unis, Europe et Japon) poursuivent l’objectif exclusif d’une restauration du système tel qu’il était avant septembre 2008. Plus intéressant est le fait que les leaders des « pays émergents » invités ont gardé le silence. Une seule phrase intelligente a été prononcée au cours de cette journée de grand cirque, par le président chinois Hu Jintao, qui a fait observer, « en passant », sans insister et avec le sourire (narquois ?), qu’il faudra bien finir par envisager la mise en place d’un système financier mondial qui ne soit pas fondé sur le dollar. Quelques rares commentateurs ont immédiatement fait le rapprochement - correct – avec les propositions de Keynes en 1945.
Cette « remarque » nous rappelle à la réalité : que la crise du système du capitalisme des oligopoles est indissociable de celle de l’hégémonie des Etats Unis, à bout de souffle. Mais qui prendra la relève ? Certainement pas «l’Europe» qui n’existe pas en dehors de l’atlantisme et ne nourrit aucune ambition d’indépendance, comme l’assemblée de l’OTAN l’a démontré une fois de plus. La Chine ? Cette « menace », que les médias invoquent à satiété (un nouveau « péril jaune ») sans doute pour légitimer l’alignement atlantiste, est sans fondement. Les dirigeants chinois savent que leur pays n’en a pas les moyens, et ils n’en ont pas la volonté. La stratégie de la Chine se contente d’oeuvrer pour la promotion d’une nouvelle mondialisation, sans hégémonie. Ce que ni les Etats Unis, ni l’Europe ne pensent acceptable.
Les chances donc d’un développement possible allant dans ce sens reposent encore intégralement sur les pays du Sud
Un nouvel internationalisme des travailleurs et des peuples est nécessaire et possible
Le capitalisme historique est tout ce qu’on veut sauf durable. Il n’est qu’une parenthèse brève dans l’histoire. Sa remise en cause fondamentale - que nos penseurs contemporains, dans leur grande majorité, n’imaginent ni « possible » ni même « souhaitable » – est pourtant la condition incontournable de l’émancipation des travailleurs et des peuples dominés (ceux des périphéries, 80 % de l’humanité). Et les deux dimensions du défi sont indissociables. Il n’y aura pas de sortie du capitalisme par le moyen de la seule lutte des peuples du Nord, ou par la seule lutte des peuples dominés du Sud.
Il n’y aura de sortie du capitalisme que lorsque, et dans la mesure où, ces deux dimensions du même défi s’articuleront l’une avec l’autre. Il n’est pas « certain » que cela arrive, auquel cas le capitalisme sera « dépassé » par la destruction de la civilisation (au-delà du malaise dans la civilisation pour employer les termes de Freud), et peut être de la vie sur la Planète. Le scénario d’un « remake » possible du XXe siècle restera donc en deçà des exigences d’un engagement de l’humanité sur la longue route de la transition au socialisme mondial. Le désastre libéral impose un renouveau de la critique radicale du capitalisme. Le défi est celui auquel est confrontée la construction/reconstruction permanente de l’internationalisme des travailleurs et des peuples, face au cosmopolitisme du capital oligarchique.
La construction de cet internationalisme ne peut être envisagée que par le succès d'avancées révolutionnaires nouvelles (comme celles amorcées en Amérique latine et au Népal) ouvrant la perspective d'un dépassement du capitalisme.
Dans les pays du Sud, le combat des Etats et des nations pour une mondialisation négociée sans hégémonies – forme contemporaine de la déconnexion – soutenu par l'organisation des revendications des classes populaires peut circonscrire et limiter les pouvoirs des oligopoles de la triade impérialiste. Les forces démocratiques dans les pays du Nord doivent soutenir ce combat. Le discours «démocratique» proposé, et accepté par la majorité des gauches telles qu’elles sont, les interventions "humanitaires" conduites en son nom comme les pratiques misérables de "l'aide" écartent de leurs considérations la confrontation réelle avec ce défi.
Dans les pays du Nord les oligopoles sont déjà visiblement des "biens communs" dont la gestion ne peut être confiée aux seuls intérêts particuliers (dont la crise a démontré les résultats catastrophiques). Une gauche authentique doit avoir l'audace d'en envisager la nationalisation, étape première incontournable dans la perspective de leur socialisation par l'approfondissement de la pratique démocratique. La crise en cours permet de concevoir la cristallisation possible d'un front des forces sociales et politiques rassemblant toutes les victimes du pouvoir exclusif des oligarchies en place.
La première vague de luttes pour le socialisme, celle du XXe siècle, a démontré les limites des social-démocraties européennes, des communismes de la troisième internationale et des nationalismes populaires de l'ère de Bandoeng, l'essoufflement puis l'effondrement de leurs ambitions socialistes. La seconde vague, celle du XXIe siècle, doit en tirer les leçons. En particulier associer la socialisation de la gestion économique et l'approfondissement de la démocratisation de la société. Il n'y aura pas de socialisme sans démocratie, mais également aucune avancée démocratique hors de la perspective socialiste.
Ces objectifs stratégiques invitent à penser la construction de "convergences dans la diversité" (pour reprendre l'expression retenue par le Forum Mondial des Alternatives) des formes d'organisation et de luttes des classes dominées et exploitées. Et il n'est pas dans mon intention de condamner par avance celles de ces formes qui, à leur manière, renoueraient avec les traditions des social-démocraties, des communismes et des nationalismes populaires, ou s'en écarteraient.
Dans cette perspective, il me paraît nécessaire de penser le renouveau d'un marxisme créateur. Marx n’a jamais été aussi utile, nécessaire, pour comprendre et transformer le monde, aujourd’hui autant et même plus encore qu’hier. Etre marxiste dans cet esprit c'est partir de Marx et non s'arrêter à lui, ou à Lénine, ou à Mao, comme l'ont conçu et pratiqué les marxismes historiques du siècle dernier. C'est rendre à Marx ce qui lui revient : l'intelligence d'avoir amorcé une pensée critique moderne, critique de la réalité capitaliste et critique de ses représentations politiques, idéologiques et culturelles. Le marxisme créateur doit poursuivre l'objectif d'enrichir sans hésitation cette pensée critique par excellence. Il ne doit pas craindre d'y intégrer tous les apports de la réflexion, dans tous les domaines, y compris ceux de ces apports qui ont été considérés, à tort, comme "étrangers" par les dogmatiques des marxismes historiques du passé.
En conclusion : l’impuissance de l’économie vulgaire
Dans les moments de « crise » comme le nôtre l’impuissance de l’économie vulgaire apparaît dans toute sa plénitude
Le journal Le Monde posait à cet effet une question méchante : « Comment se fait-il que les « cracs » de Harvard n’avaient pas prévu la crise… ? ». Sont-ils donc simplement des imbéciles ? Certainement pas. Mais leur intelligence est toute entière engagée sur les seules pistes retenues par l’économie vulgaire et la fausse théorie du « capitalisme imaginaire des marchés généralisés ». Tout comme de brillants esprits d’autrefois croyaient que le débat sur le sexe des anges pouvait contribuer à mieux comprendre le monde !
L’économie vulgaire, engagée sur les pistes de l’analyse des marchés opérant sur la base d’une « information imparfaite », est alors contrainte de substituer à l’analyse de la réalité capitaliste un jeu sans fin (pour lequel les mathématiques deviennent indispensables) d’hypothèses concernant les « anticipations ». Car les hypothèses sur les « anticipations » permettent de prévoir tout et son contraire, ce que l’intelligence subtile et réaliste de Keynes avait parfaitement saisi.
Quelles « anticipations » ? Une série de bonnes blagues. Les anticipations des vendeurs de force de travail ? Les malheureux savent qu’ils n’ont guère de choix. Ils savent aussi qu’ils ne peuvent améliorer les conditions de vente de leur force de travail que par l’organisation et la lutte collective de classe. Celles des « consommateurs » qui « choisissent » (leur « supermarché »?) et « choisissent » leurs placements financiers éventuels ? Les malheureux sont bel et bien contraints de passer alors par les conseils de leurs banquiers, les décideurs véritables. Celles des entrepreneurs qui décident d’investir ou de s’en abstenir ? L’histoire démontre, comme Marx et Keynes l’avaient compris, que les cycles de sur investissement puis de dévalorisation du capital imposent leur réalité. Celles des propriétaires de capitaux qui choisissent entre le placement risqué et la préférence pour la liquidité ? L’histoire à répétition des bulles financières dont les raisons et les mécanismes ont été parfaitement analysés encore une fois par Marx, en association avec sa découverte de l’aliénation suprême des économistes vulgaires (« l’argent fait des petits », A donne A’ sans passer par la production), restera toujours hors du champ de la réflexion de nos économistes conventionnels. Celles des spéculateurs en bourse ? On sait que la meilleure position est celle prise par les moutons qui suivent le mouvement général et que cette pratique accentue nécessairement l’ampleur des oscillations.
Le naufrage dans l’océan des anticipations est le produit inévitable de la réduction de la société à une somme d’individus et à l’ignorance délibérée des réalités majeures par lesquelles se définit le capitalisme réel (les classes, la propriété privée, l’Etat, les nations etc.). Il ne s'agit là que d'une formulation idéologique au sens négatif du terme, parfaitement fonctionnelle pour donner légitimité aux pratiques réelles du capital dominant. Les économistes vulgaires qui prétendent faire œuvre scientifique n’en sont pas même conscients. Ils ne peuvent pas comprendre que pour faire œuvre scientifique, s’approcher d’une compréhension de la réalité objective, il faut partir de la critique radicale de la base de départ de leurs raisonnements.
Les économistes conventionnels ne sont pas des penseurs critiques. Ils sont, au mieux, des « technocrates ». J’aime mieux utiliser à leur endroit le vocable anglo-saxon – celui « d’executive » (agent d’exécution, ici aux ordres du capital, aujourd’hui des oligopoles).
Telle est la raison pour laquelle les « critiques » qu’ils peuvent adresser au système sont toujours marginales et les propositions de réformes qu’ils pensent « réalistes » sont en réalité parfaitement irréalistes pour l’essentiel. Et lorsque donc, pour une raison morale quelconque la réalité leur déplait (« trop de pauvreté », voire « trop d’inégalités»), le dérapage en direction des vœux pieux et du sermon en guise de politique devient inévitable. Un best seller d’un Prix Nobel d’Economie (strictement réservé aux économistes vulgaires) est de ce fait forcément un ouvrage au mieux médiocre. L’ouvrage de Joseph Stiglitz qui porte le titre pompeux de « Un autre monde », en est un bel exemple. (1s)
Stiglitz « découvre » en 2002 que le consensus de Washington n’était pas bon ; il découvre la réalité des comportements du FMI, de l’OMC, etc. Plus de la moitié de 550 pages de cet ouvrage boursouflé s’abreuve de « révélations » connues par d’autres depuis 30 ou 40 ans ! Stiglitz croit être le premier à le dire, n’ayant jamais lu les travaux des penseurs critiques (et il ne les lira probablement jamais). Il ne s’agit ici pas même d’arrogance, mais simplement d’ignorance. Exemple amusant : Stiglitz « découvre » qu’en 1990 il y a eu entente sur quelques prix par quelques oligopoles ! Merveilleux. Et que propose-t-il pour rétablir la « concurrence » : une loi « anti trust » et le recours aux tribunaux, à la mode US !
Dans cet ouvrage publié en 2002 Stiglitz ignore la financiarisation, dont il ne dit presque rien, qu’il juge inoffensive et même utile… Les travaux remarquables du regretté Giovanni Arrighi concernant la financiarisation stade ultime des hégémonies en déclin sont totalement ignorés (2)… Evidemment Stiglitz a été surpris par l’effondrement financier de 2008, dont pas une ligne de son ouvrage n’indique le sérieux de la menace. Et pourtant, aux mêmes dates, d’autres (dont moi-même) avaient analysé le système libéral mondialisé comme par nature instable, condamné à s’effondrer à travers sa crise financière (le talon d’Achille du système comme je l’écrivais). Stiglitz évidemment ignore tout cela.
L’idée qu’il se fait de lui-même, « révélant au monde » les « défauts » du système, ne peut donc que faire sourire.
On ne sera donc pas étonné que ce que j’ai appelé « le rapport Stiglitz », c'est-à-dire celui de la Commission désignée par le président en exercice de l’Assemblée Générale des Nations Unies – Padre Miguel D’Escoto – dont la présidence a été malheureusement confiée à Stiglitz, lequel a probablement imposé sa perception superficielle et limitée des problèmes dans la rédaction finale du document, ne soit pas sorti du cadre de l’orthodoxie conventionnelle réactionnaire. (3) L’ « échec » qui en est résulté – le fait que les pays du Sud aient renoncé à se faire représenter à l’assemblée par des responsables au niveau requis – est en fait, pour moi, un bon signe. Il laisse entendre que les pays du Sud ont compris que ce rapport – sous prétexte de « consensus global » et de … réalisme – s’inscrivait dans la stratégie du Nord de « réponse à la crise » et que ses propositions étaient de nature à être « acceptables » pour les oligopoles. Changer le monde ? Tu parles !
La militarisation de la mondialisation, l'« aide », le postmodernisme
Pour maintenir leur rente de monopole les oligopoles ne peuvent pas se contenter de prélever leurs ponctions sur leurs seules "économies nationales". Dans leur dimension mondiale ces oligopoles ponctionnent encore davantage les économies des périphéries dominées, émergentes ou marginalisées. Le pillage des ressources de la planète entière et la sur exploitation des travailleurs fournit la matière de la rente impérialiste qui, à son tour, constitue la condition d'un consensus social devenant alors possible dans les sociétés opulentes du Nord.
Les discours sur la démocratie et l'écologie servent d'emballage destiné à masquer les objectifs réels.
L"économie vulgaire constitue la clé de voûte de l'idéologie du capitalisme, comme on devrait le savoir depuis la "critique de l'économie politique" (sous titre du Capital de Marx). La construction de l'économie vulgaire, parce qu'elle concerne une "non réalité" (les marchés généralisés), ne mérite pas la qualification de scientifique qu'elle prétend être. Sa fonction sociale réelle est analogue à celle de la sorcellerie des temps anciens. Comme cette dernière elle recourt à un langage volontairement inaudible pour le citoyen, dont elle entend annihiler ainsi le pouvoir de décider, en lui assénant des "vérités" prétendues "objectives". En contrepoint le langage de la pensée sociale authentique reste toujours limpide, comme l'ont été les écrits de Marx, même les plus difficiles; ils éduquent les citoyens.
Mettre en déroute le contrôle militaire de la planète par les impérialistes
Le véritable défi auquel les peuples sont confrontés est d'abord la militarisation de la mondialisation. Car le contrôle militaire de la planète par les Etats-Unis et leurs alliés subalternes (l'Otan et le Japon) est devenu le seul moyen en dernier ressort qui permet la ponction de la rente impérialiste sans laquelle le système ne peut survivre. Empire du chaos, par lequel je qualifiais le système depuis 1991, et guerre permanente contre les peuples du Sud sont synonymes. C'est pourquoi mettre en déroute les forces armées de la triade, contraindre les Etats-Unis à abandonner leurs bases réparties sur tous les continents, démanteler l'Otan doivent devenir les objectifs stratégiques premiers des forces progressistes et démocratiques, au Nord et au Sud. (4)
Tel est probablement l'objectif du "groupe de Shanghai" qui amorce la renaissance de l'esprit du "non alignement", qu'on devrait alors définir comme le "non alignement sur la mondialisation impérialiste et le projet politique et militaire de la triade".
Je proposerai ici un parallèle avec l'histoire de Bandoeng. Avant même la conférence du même nom (1955) et le "non alignement" (1960), des groupes radicaux de réflexion s'étaient mobilisés pour proposer aux peuples et aux Etats d'Asie et d'Afrique des contre stratégies possibles et efficaces, contraignant l'impérialisme de l'époque à reculer. L'auteur de ces lignes a eu l'honneur et le bonheur de participer à l'un de ces groupes pour le Moyen Orient, à partir de 1950. Des initiatives analogues s'imposent aujourd'hui.
"L'aide", instrument complémentaire du contrôle des pays vulnérables
L'"aide internationale", présentée comme indispensable pour la survie des "pays les moins développés" (terminologie des Nations Unis à l'endroit de beaucoup de pays africains et de quelques autres), trouve sa place ici. Car l'objectif réel de celle-ci, destinée aux plus vulnérables des pays de la périphérie, est de dresser un obstacle supplémentaire à leur participation à un front alternatif du Sud.(5)
Les concepts concernant l’aide ont été enfermés dans un corset serré, dont l’architecture a été définie dans la Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005), elle-même rédigée au sein de l’OCDE, puis imposée aux pays bénéficiaires. La conditionnalité générale, définie par l’alignement sur les principes de la mondialisation libérale, est omniprésente. Tantôt exprimée explicitement : favoriser la libéralisation, l’ouverture des marchés, devenir « attractif » pour les investissements privés étrangers. Tantôt indirectement : respecter les règles de l’OMC. Un pays qui refuserait donc de s’inscrire dans cette stratégie définie unilatéralement par le « Nord » (la Triade) perd son droit d’éligibilité au bénéfice de l’aide. Sur ce plan la Déclaration de Paris constitue un recul – et non une avancée – en comparaison des pratiques « des décennies du développement » (1960-1970) lorsque le principe du choix libre par les pays du Sud de leur système et de leurs politiques économiques et sociales était admis.
Dans ces conditions, les politiques d’aide et leurs objectifs immédiats apparents sont indissociables des objectifs géopolitiques de l'impérialisme. Car les différentes régions de la Planète ne remplissent pas des fonctions identiques dans le système libéral mondialisé. Il n’est donc pas suffisant de mentionner ce qui constitue leur dénominateur commun (libéralisation des échanges, ouverture au flux financiers, privatisations).
L’Afrique sub-saharienne est parfaitement intégrée dans ce système global, et en aucune manière « marginalisée » comme on le dit hélas, sans réfléchir, trop souvent : le commerce extérieur de la région représente 45 % de son PIB, contre 30 % pour l’Asie et l’Amérique latine, 15 % pour chacune des trois régions constitutives de la triade. L’Afrique est donc quantitativement « plus » et non « moins » intégrée, mais elle l’est différemment.(6)
La géo-économie de la région repose sur deux ensembles de productions déterminantes dans le façonnement de ses structures et la définition de sa place dans le système global :
(i) des productions agricoles d’exportation « tropicales » : café, cacao, cotons, arachides, fruits, huile de palme etc,
(ii) les hydrocarbures et des productions minières : cuivre, or, métaux rares, diamant etc. Les premiers sont les moyens de « survie », au-delà de la production vivrière destinée à l’auto-consommation des paysans, qui financent la greffe de l’Etat sur l’économie locale et, à partir des dépenses publiques, la reproduction des « classes moyennes ». Ces productions intéressent plus les classes dirigeantes locales que les économies dominantes. Par contre, ce qui intéresse au plus haut point ces dernières ce sont les produits des ressources naturelles du continent. Aujourd’hui les hydrocarbures et les minerais rares. Demain les réserves pour le développement des agro-carburants, le soleil (lorsque le transport à longue distance de l’électricité solaire le permettra, dans quelques décennies), l’eau (lorsque son « exportation » directe ou indirecte le permettra).
La course aux territoires ruraux destinés à être convertis à l’expansion des agro-carburants est engagée en Amérique latine. L’Afrique offre, sur ce plan, de gigantesques possibilités. Madagascar a amorcé le mouvement et déjà concédé des superficies importantes de l’Ouest du pays. La mise en œuvre du code rural congolais (2008), inspiré par la coopération belge et la FAO, permettra sans doute à l’agri-business de s’emparer à grande échelle de sols agraires pour les « mettre en valeur », comme le Code Minier avait permis naguère le pillage des ressources minérales de la colonie. Les paysans, inutiles, en feront les frais ; la misère aggravée qui les attend intéressera peut être l’aide humanitaire de demain et des programmes « d’aide » pour la réduction de la pauvreté ! J’avais eu connaissance, dans les années 1970, d’un vieux rêve colonial pour le Sahel : en expulser la population (les Sahéliens inutiles) au bénéfice de ranchs (à la texane) d’élevage extensif pour l’exportation.
La nouvelle phase de l’histoire qui s’ouvre est caractérisée par l’aiguisement des conflits pour l’accès aux ressources naturelles de la planète. La triade entend se réserver l’accès exclusif à cette Afrique « utile » (celle des réserves de ressources naturelles), et en interdire l’accès aux « pays émergents » dont les besoins sur ce plan sont déjà considérables et le seront de plus en plus. La garantie de cet accès exclusif passe par le contrôle politique et la réduction des Etats africains au statut d’ « Etats clients ».
Il n’est donc pas abusif de considérer que l’objectif de l’aide est de « corrompre » les classes dirigeantes. Au-delà des ponctions financières (bien connues hélas, et pour lesquelles ont fait semblant de croire que les donateurs n’y sont pour rien !), l’aide devenue « indispensable » (puisqu’elle devient une source importance de financement des budgets) remplit cette fonction politique. Il est alors nécessaire que l'aide soit conçue pour devenir permanente et non pour préparer sa disparition par un développement conséquent. Il est alors important que cette aide ne soit pas réservée exclusivement et intégralement aux classes aux postes de commande, au « gouvernement ». Il faut aussi qu’elle intéresse également les « oppositions » capables de leur succéder. Le rôle de la société dite civile et de certaines ONG trouve sa place ici. L’aide en question, pour être réellement politiquement efficace, doit également contribuer à maintenir l’insertion des paysans dans ce système global, cette insertion alimentant l’autre source des revenus de l’Etat. L’aide doit donc également s’intéresser au progrès de la «modernisation » des cultures d’exportation.
La critique de droite de l'aide procède de l'idée qu'il ne tient qu'aux pays concernés à faire en sorte qu'ils puissent se libérer de cette dépendance, en s'ouvrant davantage aux capitaux extérieurs. Tel est en substance ce que les discours de Sarkozy à Dakar et d'Obama à Accra ont voulu dire. On élude par ce procédé oratoire la véritable question. Car l'aide, partie intégrante de la stratégie impérialiste, cherche en réalité à marginaliser les peuples africains, inutiles et encombrants, pour mieux piller les ressources de l'Afrique!
La critique de la gauche "bon enfant", celle de nombreuses ONG, fait comme si on pouvait prendre au mot les engagements proclamés par les "donateurs". Cette critique s'enferme alors dans les discours oiseux concernant "la capacité d'absorption", "la performance", la "bonne gouvernance" promue par la "société civile". Elle réclame "plus" et "mieux" d'aide ! En contrepoint la critique radicale s'inscrit dans la perspective d'un développement autocentré. L'aide éventuelle qu'on pourrait imaginer dans ce cadre procède alors des logiques de la solidarité internationaliste des peuples, face (et contre) le cosmopolitisme du capital.
La pauvreté, la société civile, la bonne gouvernance : la rhétorique pauvre du discours dominant
Ce discours dominant prétend se donner l’objectif de « réduire, voire éradiquer la pauvreté », en s’appuyant sur la « société civile », pour substituer une « bonne gouvernance » à une autre, jugée « mauvaise ».
Le terme même de « pauvreté » relève d’un langage vieux comme le monde, celui de la charité (d’origine religieuse ou autre). Cette langue appartient au passé, non au présent, a fortiori à l’avenir. Il est antérieur à la constitution du langage développé par la pensée sociale moderne, qui cherche à être scientifique, c'est-à-dire à découvrir les mécanismes qui engendrent un phénomène observable et observé.
La masse gigantesque de la littérature sur la pauvreté porte son attention exclusive – ou presque – sur le « repérage » du phénomène et sa quantification. Elle ne pose pas les questions en amont : quels sont les mécanismes qui engendrent la pauvreté en question ? Ont-ils quelques rapports avec les règles fondamentales (comme la compétition) qui constituent la base de nos systèmes ? En particulier, pour ce qui concerne les pays du Sud assistés, les stratégies et politiques de développement conçues pour eux.
Le concept de « société civile », même pris au sérieux (sans parler donc de son usage à tord et à travers), s’érige-t-il à la hauteur de ce qu’un concept doit être pour tenter sa chance et mériter d’entrer dans le débat sérieux à vocation scientifique ? Telle qu’elle nous est proposée, la « société civile » en question est associée à une idéologie du consensus. Double consensus :
(i) qu’il n’y a pas d’alternative à « l’économie de marché » (expression elle-même vulgaire pour servir de substitut à l’analyse du « capitalisme réellement existant », d’hier et d’aujourd’hui) ;
(ii) qu’il n’y a pas d’alternative à la démocratie représentative fondée sur le multipartisme électoral (conçue comme « la démocratie »), pour servir de substitut à la conception d’une démocratisation de la société, étant elle-même un processus sans fin.
En contrepoint l'histoire des luttes a permis l'émergence de cultures politiques du conflit, fondées sur la reconnaissance du conflit des intérêts sociaux et nationaux, donnant entre autre un sens aux termes de « droite » et « gauche », attribuant à la démocratie créatrice le droit et le pouvoir d’imaginer des alternatives et non exclusivement des « alternances » dans l’exercice du pouvoir (changer les noms pour faire la même chose).
La « gouvernance » a été inventée comme substitut au « pouvoir ». L’opposition entre ses deux qualificatifs – bonne ou mauvaise gouvernance – rappelle le manichéisme et le moralisme, substitué à l’analyse de la réalité, aussi scientifique que possible. Encore une fois cette mode nous vient de la société d’outre Atlantique, où le sermon a souvent dominé le discours politique. La « bonne gouvernance » implique que le « décideur » soit « juste », « objectif » (retienne la « meilleure solution »), « neutre » (acceptant la présentation symétrique des arguments), et par-dessus tout « honnête » (y compris bien entendu au sens le plus platement financier du terme). A lire la littérature produite par la Banque Mondiale sur le sujet, on se découvre relire les doléances présentées – en général par des hommes (peu de femmes !) de religion et/ou de droit – dans les temps anciens de l’Orient au « despote juste » (pas même éclairé !).
L’idéologie visible sous jacente s’emploie tout simplement à évacuer la question véritable : quels intérêts sociaux le pouvoir en place, quelqu’il soit, représente et défend ? Comment faire avancer la transformation du pouvoir pour qu’il devienne progressivement l’instrument des majorités, en particulier des victimes du système tel qu’il est ? Etant entendu que la recette électorale pluripartiste a prouvé ses limites de ce point de vue.
Le discours "post moderniste"
Le post modernisme clôture le discours intitulé par certains "nouvel esprit du capitalisme", mais qui mériterait mieux le qualificatif d'idéologie du capitalisme/impérialisme tardif des oligopoles. Je renvoie ici le lecteur au livre de Nkolo Foe (Le Post modernisme; Codesria 2009) qui en établit avec puissance la substance, parfaitement fonctionnelle pour servir les intérêts réels des forces dominantes.(8)
Le modernisme a été mis en place par le discours des Lumières au XVIIIe siècle européen, en association avec le triomphe de la forme historique européenne du capitalisme et de l'impérialisme qui lui est consubstantiel, et par la suite a conquis le monde. Il en véhicule les contradictions et les limites. L'ambition d'universalisme qu'il formule est défini par l'affirmation de droits de l'homme (pas nécessairement de la femme!) qui sont en substance ceux de l'individualisme bourgeois. Le capitalisme réel auquel cette forme de modernité est associée est de surcroît un impérialisme qui nie les droits des peuples non européens conquis et soumis à la ponction de la rente impérialiste.
La critique de cette modernité bourgeoise et capitaliste/impérialiste est certainement nécessaire. Et Marx avait effectivement entrepris cette critique radicale qu'il sera toujours nécessaire de mettre à jour et d'approfondir.
La nouvelle Raison se voulait émancipatrice; et elle l'était dans la mesure où elle libérait la société des aliénations et des oppressions des anciens régimes, et par là même garante du progrès, plus exactement d'une forme de progrès limité et contradictoire. Car cette raison était celle de la gestion de la société par le capital en dernier ressort.
Le post modernisme ne propose pas cette critique radicale pour aller de l'avant en direction de l'émancipation des individus et de la société par le socialisme. Il propose en revanche un retour aux aliénations pré modernes, pré capitalistes. Les formes de sociabilité qu'il s'emploie à promouvoir s'inscrivent obligatoirement dans l'adhésion identitaire "tribaliste" à des communautés (para religieuses ou para ethniques), aux antipodes des exigences de l'approfondissement de la démocratie devenue synonyme de "tyrannie du peuple", osant mettre en question la gestion sage des executives au service des oligopoles. Les critiques qu'il propose des "grands discours" (des Lumières, de la démocratie, du progrès, du socialisme, de la libération nationale) ne regardent pas en direction de l'avenir mais se tournent vers un passé imaginaire et faux, au demeurant parfaitement idéalisé. Il facilite de la sorte l'extrême fragmentation des majorités populaires et leur fait accepter l'ajustement aux logiques de la reproduction de la domination des oligopoles et de l'impérialisme. Car cette fragmentation ne gêne pas cette domination, au contraire elle en facilite la tâche. L'individu en question ne devient pas l'agent conscient et lucide de la transformation sociale, mais l'esclave de la marchandisation triomphante. Le citoyen disparaît pour laisser la place au consommateur/spectateur. Ce n'est plus un citoyen qui ambitionne l'émancipation, mais un être falot qui accepte la soumission.
NOTE
1) Joseph Stiglitz, Un autre monde, contre le fanatisme des marchés; Livre de poche, Paris
2009.
2) Giovanni Arrighi The long XXth century, op cit
3) Les documents de l' ONU en question ici sont publiés sur les sites de l'organisation
4) Samir Amin, L'Empire du Chaos, Harmattan 1991 ; Samir Amin, L'hégémonie des Etats-Unis et l'effacement du projet européen; Harmattan 2000
5) Samir Amin, Aid, for what development; contribution dans le livre publié en anglais par Fahamu (en cours de publication, 2009)
6) Samir Amin, Is Africa really marginalized?, in, Helen Lauer (ed), History and philosophy of sciences; Hope Pub, Ibadan, 2003.
7) Nkolo Foe, Le post modernisme et le nouvel esprit du capitalisme, Sur une philosophie globale d' Empire; Codesria, Dakar 2009 ; Samir Amin,Modernité, religion, démocratie, critique des culturalisme; Parangon 2008 ; Samir Amin, Sur la crise, op cit, chap 2 et 3. ; Jacques Rancière, La haine de la démocratie, La Fabrique 2008.
8) Samir Amin, Beyond liberal Globalization; Monthly Review, NY, dec 2006
* Samir Amin dirige le Forum pour le développement du Tiers-Monde – Le titre original du texte est : «Les champs de bataille de l’impérialisme contemporain et les conditions d'une réponse efficace du Sud»
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 609 lectures