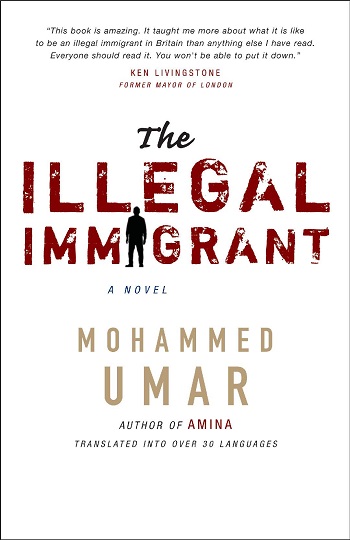Vingt ans après son accession au pouvoir le bilan de l’ANC est marqué par l’ambivalence. D’un côté le maintien des objectifs historiques de liquidation de l’héritage de l’apartheid, des dépenses sociales considérables et des politiques de discrimination positive, de l’autre des politiques économiques néolibérales - aujourd’hui mises en cause ! - ayant comprimé le marché du travail et maintenu la majorité de la population noire dans les affres de l’économie informelle.
A la fois pragmatique et traversé par des courants idéologiques divers, l’Anc, au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994, semble toujours vouloir combiner le nationalisme africain - nationalisme inclusif « d’unité dans la diversité » - avec un projet d’émancipation et de justice sociale. Cette ambition, clairement inscrite dans son programme originel - la « Freedom Charter » de 1955 -, est endossée depuis lors par ses alliés historiques, les syndicats progressistes de la Cosatu [1] et le parti communiste (Sacp).
Si d’aucuns avaient espéré pouvoir passer à un projet socialiste aussitôt le pouvoir politique conquis, les circonstances concrètes d’une transition négociée, la situation de l’État comme de l’économie nationale, ainsi que le contexte du néolibéralisme triomphant des années 1990 l’ont néanmoins empêché.
La victoire sud-africaine sur plus de trois siècles de colonialisme puis d’apartheid a été le fait d’un nationalisme populaire vigoureux à caractère insurrectionnel. Ceci explique l’adhésion populaire massive non démentie au projet de l’Anc vingt ans après l’avènement de la démocratie, malgré l’impatience et les déceptions. L’Anc se veut toujours un mouvement de libération, une alliance de classes sociales et de groupes divers (a broad church) qui, au niveau national, adhère à un modèle d’unité et de consensus par le dialogue. Son but stratégique s’énonce clairement : la libération économique et socio-économique, sans laquelle la libération nationale reste incomplète.
À l’heure actuelle, il s’agit donc à la fois de déconstruire l’héritage socio-économique - basé sur la race, le colonialisme et l’apartheid - en le remplaçant par la justice sociale, et de combattre l’impérialisme en faveur du développement. En parcourant dans les grandes lignes les voies empruntées par l’ANC depuis 1994, on constate que ces deux enjeux sont demeurés centraux, en dépit d’une volte-face désarçonnante pendant la première phase de la transition.
L’ANC AU POUVOIR
« Trop de choses sont imputées au néolibéralisme. L’Anc a hérité d’un État en faillite ; leur néolibéralisme était accidentel, ils essaient désespérément de réparer cela », estime le professeur Keith Breckenridge de l’Université du Witwatersrand (Ferreira, 2013). En effet, le premier gouvernement démocratique de l’histoire sud-africaine a d’emblée dû faire face à une économie en récession sur le point de s’effondrer. Qui plus est le pouvoir économique de l’État venait d’être amputé par les mesures libérales prises par l’ex-président de Klerk, tandis que l’état des finances publiques ne permettait pas à l’Anc d’exécuter son grand programme de reconstruction et de développement.
D’autre part, malgré les propositions attrayantes de la Banque mondiale, le nouveau pouvoir refusait de tomber dans le piège de l’endettement et des « conditionnalités » - il désirait garder ses marges de manœuvre politiques. Le projet initial - la transformation et l’expansion rapides de l’économie sud-africaine, jusqu’alors calibrée en fonction des seuls intérêts de la minorité blanche, afin d’absorber le plus vite possible un maximum de travailleurs et paysans noirs [2] « désavantagés » et de leur offrir des emplois corrects - étant ainsi exclu, l’Anc dû se résoudre au « long chemin ».
La réponse de l’économiste Thabo Mbeki (alors vice-président) à ces défis suivit deux lignes maîtresses. D’une part, une politique macro-économique ayant pour objectifs la stabilisation de l’économie, la relance de la croissance et le remboursement des dettes moyennant des investissements étrangers. D’autre part, l’obtention d’un pouvoir économique par une fraction de la population noire, destinée à acquérir la maîtrise du fonctionnement des hautes sphères de l’économie, qui faisait cruellement défaut dans l’Anc.
Le premier objectif fut atteint. Il fallut cependant plusieurs années pour apercevoir les graves dommages que sa poursuite avait causée au commerce et à l’industrialisation (3). Les investisseurs étrangers, attirés par les ouvertures de Mbeki, rachetèrent simplement les entreprises locales au lieu d’investir dans de nouveaux projets, ou les détruisirent à travers la concurrence de produits importés. Les secteurs jadis pourvoyeurs importants d’emplois, même non ou peu qualifiés, tels que l’automobile et le textile, se trouvèrent en grande difficulté, avec pour conséquence la perte de centaines de milliers d’emplois et la reprise de la quasi-totalité du commerce de détail par des chaînes transnationales.
Même des industries spécialisées, telle que la fabrication de machinerie minière, furent déclassées par les importations. Par ailleurs, grâce à la croissance économique et au fait que les classes moyennes noires ont finalement vu l’accès à l’emploi déverrouillé, le secteur financier a connu un essor foudroyant. Les citoyens se sont endettés lourdement à des taux très élevés et l’épargne fait défaut.
La deuxième ligne maîtresse de la politique de Mbeki fut le Black Economic Empowerment (Bee) d’une élite de Noirs triés sur le volet. Les grandes compagnies furent incitées à céder entre 20 et 25% de leurs actions dans ce but et le gouvernement se chargea des facilités de crédit pour l’investissement. En d’autres mots, l’ANC s’engagea dans la formation d’une classe capitaliste noire « patriotique », sensée servir les intérêts nationaux plutôt que ceux des forces impérialistes.
L’État lui-même investit dans des secteurs clé et y plaça ses représentants. Les bénéficiaires du Bee restèrent en général actifs politiquement et certains retournèrent effectivement dans la sphère de l’État pour occuper de hautes fonctions, à l’instar d’un Tokyo Sexwale (ministre du Logement) ou d’un Cyril Ramaphosa (vice-président de l’Anc). L’avenir dira les effets politiques de cette nouvelle, mais petite classe. Cependant, les bénéficiaires du Bee ne produisent rien ; leur capital se trouve dans les multiples « Bee holdings ». Ils n’apportent donc que peu, voire rien, au développement industriel et à la création d’emplois.
Qui plus est, au sein de l’Anc, le Bee a eu des conséquences ravageuses sur le plan de la moralité politique. Des tendances prévaricatrices se sont répandues rapidement parmi les représentants du mouvement de libération. Le pas vers le clientélisme, les accords douteux et même la corruption (les appâts ne manquaient pas) fut rapidement franchi par certains. Le chômage aidant, le virus se répandit ensuite à travers tout le mouvement, notamment dans la course aux emplois dans la fonction publique.
Qui connaît l’histoire du capitalisme Afrikaner et a été témoin de l’amalgame du parti nationaliste de l’apartheid et de l’État est néanmoins enclin à pardonner les militants à la base… L’Anc est monté au créneau pour réinsuffler un esprit civique, mais la tâche est d’autant plus ardue que les personnes compétentes restent rares.
UN CHANGEMENT DE CAP
L’Anc a néanmoins imprimé un nouveau cap à sa politique économique en 2008, en lançant un grand programme de développement visant la création de onze millions d’emplois formels en vingt ans, moyennant une stratégie de transformation de l’économie sous la guidance de l’État. Le Bee a été abandonné. Actuellement, seul 10% du capital sud-africain se trouve entre les mains de citoyens noirs, tandis que 90% reste blanc. Blanc majoritairement étranger qui plus est : 70% des actionnaires de la bourse de Johannesburg ne sont pas des nationaux.
Cette emprise internationale sur l’économie sud-africaine complique la mise en œuvre de la nouvelle politique de développement économique, les grands acteurs économiques renaclant à se conformer aux objectifs de développement fixés par l’Anc. Des stratégies de négociation difficiles s’ensuivent avec les investisseurs extérieurs, au besoin épaulés par des mesures contraignantes. C’est ainsi que le gouvernement a récemment révoqué les traités bilatéraux d’investissement avec des pays européens, qui devraient servir de garantie pour les investisseurs de ces pays mais qui leur permettaient aussi, par le biais de la Cour d’arbitrage occidentale, de contourner les objectifs de développement, voire de désobéir à certaines lois considérées comme des entraves aux « libre marché ».
L’Afrique du Sud a également décidé de ne pas reconduire certains accords de coopération au développement, dont celui avec la Belgique, sans doute pour stimuler une solidarité internationale dans l’égalité, sans « conditionnalités » vécues comme autant de mises sous tutelle.
Le gouvernement et le parlement sont engagés actuellement dans un bras de fer avec les compagnies minières au sujet de la transformation des ressources minières. Jusqu’ici toute la production minière est exportée sous forme brute, suivant le schéma colonial classique. L’Anc veut qu’une partie (on parle de 30%) de la production soit dorénavant vendue localement, à un prix favorable, afin d’y ajouter de la valeur (Turok, 2013).
Dans ce contexte, l’Anc n’hésite pas à entretenir un savant dosage d’ambiguïté quant au désir de nationalisation « du peuple » et dans ses rangs. Au niveau international, l’Anc met en œuvre une politique régionale, dans le cadre de l’Union africaine et de l’initiative Ibsa notamment, opposée aux échanges et traités inégaux, à la tactique impérialiste des accords bilatéraux. Cette orientation promeut le respect des accords et programmes africains dans les échanges Sud-Sud. Le tout s’inscrit dans une stratégie anti-impérialiste dans laquelle le développement national et africain ainsi que les échanges Sud-Sud sont les priorités pour l’avenir.
Tout en soulignant les effets nocifs de la politique « néolibérale » de Mbeki, ne pas reconnaître ses bienfaits reviendrait à sous-estimer grossièrement les stratégies et forces à mettre en œuvre dans la lutte contre les forces diffuses, souvent subtiles, de l’impérialisme, toujours habillé en bienfaiteur et maître dans le détournement des meilleures volontés. Ainsi, le revenu moyen des Sud-Africains a augmenté de 30% en dix ans.
L’activité économique ainsi que le tourisme ont également augmenté, entraînant un énorme programme de travaux publics qui durera encore plusieurs années. Le nombre d’étudiants et de diplômés de l’enseignement supérieur a lui explosé. Les fondations venant en aide à des démunis ou de jeunes prometteurs ne se comptent plus. Les arts sont florissants… Cependant, les grands médias, encore fortement orientés vers l’Occident, n’ont guère changé et, de manière générale, le manque de compréhension et de débat entre des pans entiers de la société mène à un unanimisme inquiétant de part et d’autre…
DEUX DEFIS MAJEURS
Deux problèmes capitaux demeurent : le chômage et l’inégalité. Le premier stagne autour de 40%, mais – ce qui est plus grave – touche essentiellement la jeunesse : 80% des chômeurs sont des jeunes. L’inégalité indique que l’augmentation des revenus concerne surtout les classes moyennes et supérieures. Les indices de pauvreté baissent, mais péniblement et de quelques pourcents seulement.
Si la lutte contre la pauvreté est menée avec énergie depuis 1994, la moitié du budget national étant consacrée à des dépenses sociales (allocation vieillesse, allocations familiales, construction de trois à quatre millions de logements, accès à l’électricité, à l’eau potable, etc.), 16% des Sud-Africains vivent toujours dans des bidonvilles. Une situation entretenue par l’exode des régions les plus durement touchées par la désindustrialisation et l’exode rural des anciens bantoustans. Le désenclavement géographique et économique de ces espaces isolés, surpeuplés et gravement précarisés, créés par l’apartheid comme des véritables zones de délestage humain, avance trop lentement. C’est de ces régions que vient encore et toujours la main d’œuvre migrante, dont la grande majorité des mineurs.
La construction de logements n’ayant pu suivre le rythme des besoins, le gouvernement a dû se résoudre à installer l’électricité et l’eau potable dans les bidonvilles. Mais le processus est compliqué et trop lent. C’est surtout dans ces endroits de misère, foyers de violence et de chômage aigu, que les gens sont excédés et protestent. Cependant, selon Keith Breckenridge, l’Anc n’a pas abandonné les pauvres : « Un transfert extraordinaire de ressources des riches vers les pauvres a eu lieu ces dix dernières années, bien que la plupart des gens sentent que c’est atrocement insuffisant. Les pauvres ont toujours vécu dans des conditions épouvantables, contre lesquelles ils doivent protester. La question n’est pas les protestations en tant que telles, mais le fait que les systèmes de représentation sont rompus » (Ferreira, 2013).
La pauvreté a la peau noire. Elle montre son visage le plus criant dans les bidonvilles et les grèves, mais elle est partout, dans les townships, dans les anciens bantoustans, dans les campagnes encore « blanches », dans les rues des villes jadis ‘blanches’, dans les têtes. Elle tenaille la même masse d’ouvriers et de paysans africains, plongés dans la même débrouille et la même insécurité qu’au temps de l’apartheid. Breckenridge a raison : les pauvres doivent s’insurger, exiger « l’impossible » et se faire représenter. Ils ne peuvent se permettre de rester enfermés dans la dévalorisation de leur être, accepter la chosification à laquelle les condamnaient le colonialisme puis l’apartheid. La lutte contre la pauvreté constitue un début de réparation. Mais elle n’équivaut pas au développement et aborde à peine la justice sociale.
Un grand programme de discrimination positive en faveur des Noirs et des femmes a été mis en place en 1994. Il est suivi par tous les employeurs par le biais de quotas et de sortes de « bulletins à points ». Cela a permis l’essor des classes moyennes noires, mais n’a pas profité aux ouvriers africains, ceux-ci occupant de toute façon tous les postes les moins qualifiés disponibles. [3] Grâce au dialogue social institutionnalisé et à une législation en évolution constantes, de grandes avancées en matière de salaires et de conditions de travail pour les ouvriers ont vu le jour, mais elles sont insuffisantes et inégales d’un secteur économique et d’une région à l’autre.
La masse des exclus et marginalisés reste condamnée à se débrouiller pour survivre au sein du secteur informel. La forte tendance actuelle à la flexibilisation et à la sous-traitance aggrave encore l’insécurité et les risques de perdre son emploi et de « tomber » dans l’économie informelle. Or les accords sectoriels, avec leurs salaires minimum, leur législation du travail et leur action syndicale, restent limités à la « grande économie », la formelle. Aussi le secteur informel garde son rôle colonial, encore renforcé par l’apartheid : celui de grand réservoir de main d’œuvre africaine, corvéable à merci et « jetable ». La formalisation spontanée des activités informelles, au fur et à mesure de la croissance économique, s’avère rarissime depuis les temps modernes et constitue plutôt une illusion savamment entretenue dans l’intérêt du capitalisme.
L’Anc a misé sur le développement socio-économique et la justice sociale, à partir de la transformation et de l’expansion de l’économie nationale d’une part, de l’affaiblissement jusqu’au renversement des rapports de force inégaux au niveau mondial d’autre part. En ce sens, l’aide au développement du Nord vers le Sud restera du domaine du pansement - certes parfois bienvenu et de bonne volonté - tant qu’elle demeurera embrigadée dans ces rapports de force. Que la lutte pour la libération nationale et socio-économique de l’Anc soit, comme toute lutte de libération d’envergure, pleine d’embûches, d’erreurs et même de trahisons, n’empêche pas d’avancer, à condition d’y croire et de mettre en œuvre les stratégies les plus pertinentes.
CE TEXTE VOUS A ETE PROPOSE PAR PAMBAZUKA NEWS
* Ne vous faites pas seulement offrir Pambazuka ! Devenez un Ami de Pambazuka et faites un don MAINTENANT pour aider à maintenir Pambazuka LIBRE et INDEPENDANT ! http://www.pambazuka.org/fr/friends.php
** Hélène Passtoors est militante anti-apartheid et membre de l’Anc (source : http://www.cetri.be)
*** Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur le site de Pambazuka News
**** Les opinions exprimées dans les textes reflètent les points de vue des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de la rédaction de Pambazuka News
BIBLIOGRAPHIE
- Ferreira L. (2013), « Social Justice calls for new thinking », Mail & Guardian (Afrique du Sud) 15/11/2013.
- Turok B. (2013), « It is time to take an objective view of the role of mining », Business Day, 16/09/2013 http://www.bdlive.co.za/opinion/2013/09/16/it-is-time-to-take-an-objective-view-of-the-role-of-mining
NOTES
1] Le Cosatu, pour Congress of South African Trade Union, est la principale fédération syndicale d’Afrique du Sud.
2] J’utilise ici la terminologie officielle, dans laquelle « noir » se réfère à tous les groupes précédemment « désavantagés » et opprimés, à savoir les Africains, Métis et Indiens.
3] Encore un héritage de l’apartheid, qui par décret garantissait aux ouvriers blancs les postes de niveau supérieur (genre superviseurs) et en interdisait l’accès aux ouvriers noirs, même mieux qualifiés, qui occupaient donc la totalité des jobs du bas de l’échelle.
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 458 lectures