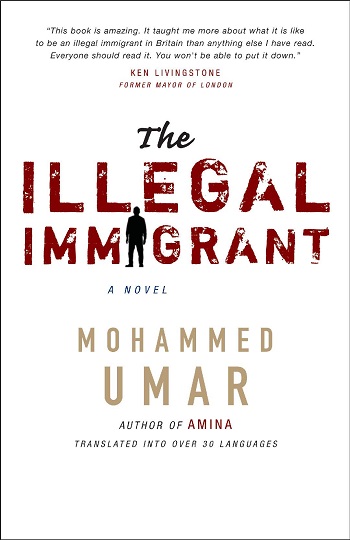Les questions de démocratie et d’environnement sont devenus le socle sur lequel s’édifient les arguments de domination et d’assujettissement des pays du Sud par le Nord. Samir Amin analyse l’évolution de ces concepts dans un contexte où la mondialisation barbare, la financiarisation, l’hégémonie des Etats-Unis, la militarisation de la gestion de la mondialisation au service des oligopoles, etc., vont de pair avec «le pillage des ressources de la planète» et l’«abandon de la perspective du développement du Sud». Pour l’économiste altermondialiste qu’est M. Amin, le progrès démocratique ne peut se concevoir hors de la perspective socialiste, tout comme il pense que le socialisme ne peut se construire sans démocratie. De même, il situe la destruction de l’environnement naturel comme une conséquence de la logique de l’accumulation capitaliste. Au-delà de ces constats, il pose les conditions d'une réponse efficace des peuples et des Etats du Sud.
Dans l’art de la guerre, chacun des belligérants choisit le (ou les) champ de bataille sur le terrain duquel il pense disposer de l’avantage pour conduire son offensive et tente de l’imposer à l’adversaire, qu’il place alors dans une position de défensive. Il en est de même en politique, tant aux niveaux nationaux que de la conduite des luttes sur les terrains de la géopolitique. Aujourd’hui, c'est-à-dire depuis une trentaine d’années, les puissances de la triade de l’impérialisme collectif (Etats-Unis, Europe occidentale, Japon) ont défini deux terrains du champ des batailles toujours en cours : la « démocratie » et « l’environnement ».
L’objet de ce papier est d’abord d’examiner les concepts et la substance retenus dans les définitions de chacun des deux thèmes choisis par les puissances de la triade et d’en faire l’analyse critique du point de vue des intérêts des peuples, des nations et des Etats visés (les pays du Sud, après ceux de l’ex-Est). On rappellera ensuite le rôle de la panoplie des instruments mis en œuvre par les stratégies de l’impérialisme pour conduire sa bataille : la mondialisation « libérale » avec son idéologie d’accompagnement (l’économie conventionnelle), la militarisation de la mondialisation, la "bonne gouvernance", "l’aide", "la guerre au terrorisme" et les guerres préventives, les discours idéologiques d'accompagnement (le post modernisme culturaliste). En contrepoint on fera apparaître les conditions d'une réponse efficace des peuples et des Etats du Sud au défi du redéploiement de l'offensive de l'impérialisme de la triade.
La « démocratie », quelle « démocratie » ?
Le coup de génie des diplomaties de l’alliance atlantique a été de choisir le terrain de la « démocratie » pour engager leur offensive qui visait, dès le départ, le démantèlement de l’Union Soviétique et la reconquête des pays de l’Europe de l’Est. Un choix qui remonte aux années 1970 et s’est progressivement cristallisé dans la mise en place de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) puis la signature de l'Acte final à Helsinki en 1975. Jacques Andreani, dans son livre au titre évocateur ( Le Piège, Helsinki et la chute du communisme; Odile Jacob 2005), explique comment les Soviétiques, qui attendaient de l'accord un désarmement de l'Otan et une détente authentique, ont tout simplement été trompés par leurs partenaires occidentaux. (1)
Il s’agissait bien d’un coup de génie parce que la « question démocratique » était une question vraie et que le moins qu’on puisse dire est que les régimes soviétiques n’étaient certainement pas « démocratiques », quelle que soit la définition retenue pour le concept et sa pratique. Les pays de l’Alliance Atlantique, en contrepoint, pouvaient s’auto qualifier de « démocratiques », quelles qu’aient été les limites et les contradictions de leurs pratiques politiques réelles associées à leur soumission aux exigences de la reproduction capitaliste. La comparaison des systèmes opérait visiblement en leur faveur. Ce discours démocratique devait alors être progressivement substitué à celui que tenaient les soviétiques et leurs alliés, celui de la « coexistence pacifique » associée au « respect » des pratiques politiques des uns et des autres et au principe de « non ingérence » dans leurs affaires intérieures.
Le discours de la coexistence avait connu ses moments forts. Qu’on se souvienne par exemple de l’écho de l’Appel de Stockholm qui, dans les années 1950, rappelait aux peuples la menace nucléaire réelle impliquée par les options de la diplomatie agressive des Etats Unis, déployées depuis la Conférence de Potsdam (1945), renforcées par les bombardements atomiques du Japon au lendemain même de la Conférence. Mais, simultanément, le choix de cette stratégie (coexistence et non ingérence) convenait – ou pouvait convenir selon les moments – aux pouvoirs dominants en place à l’Ouest et à l’Est. Car ce discours faisait accepter, comme allant de soi, la réalité des qualifications respectives de « capitaliste » et de « socialiste » retenues pour les pays de l’Ouest et de l’Est. Il évacuait toute discussion sérieuse concernant la nature précise de chacun des deux systèmes, c'est-à-dire d’examiner d’une part celle du capitalisme réellement existant de notre époque (le capitalisme des oligopoles) et d’autre part celle du « socialisme réellement existant ».
En leur lieu et place, l’ONU (avec l’accord tacite des pouvoirs des deux mondes en question) substituait aux vocables de « capitalisme » et « socialisme » ceux de « économies de marché » et « économies centralement planifiées » (ou,, pour être méchant « économies administrées »). Ces deux qualificatifs – faux l’un et l’autre (c'est-à-dire vrais en apparence superficielle seulement) – permettaient, selon les moments, de placer l’accent sur la « convergence des systèmes », convergence elle-même imposée par la technologie moderne (une thèse – fausse également – procédant d’une conception techniciste moniste de l’histoire), et de donner sa place à la coexistence afin de faciliter cette convergence « naturelle »; ou de placer au contraire l’accent sur l’opposition irréductible entre d’une part le modèle « démocratique » (associé à l’économie de marché) et d’autre part le modèle de « totalitarisme » (produit par l’économie « administrée »), dans les moments de guerre froide.
Le choix de centrer la bataille autour de la « démocratie » permettait de faire l’option d’une « irréductibilité » des systèmes et de n’offrir aux pays de l’Est que la perspective d’une capitulation, par un retour au capitalisme (le « marché ») qui devait alors produire – naturellement – les conditions d’une démocratisation. Que cela n’ait pas été le cas (pour la Russie post soviétique) ou ne l’ait été que dans des formes caricaturales extrêmes (pour les ethnocraties d’ici et là dans l’Est européen) constitue une autre affaire.
On pourrait faire observer que le discours « démocratique » des pays de l’alliance atlantique est récent. Car à l’origine l’OTAN s’est parfaitement accommodé de Salazar, des généraux turcs et des colonels grecs. A la même époque, les diplomaties de la triade ont soutenu (et souvent mis en place) les pires dictatures que l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie ont connues.
Au départ le nouveau discours démocratique n’a été adopté qu’avec beaucoup de réticences. Beaucoup des responsables politiques majeurs de l’alliance atlantique en voyaient les inconvénients, gênants pour la « real-politik » de leur préférence. Il a fallu Carter à la présidence des Etats Unis (un peu comme Obama aujourd’hui) pour faire comprendre que le sermon « moral » sur le thème démocratique était porteur. Il a fallu Mitterand en France pour rompre avec la tradition gaulliste de refus de la « coupure » imposée en Europe par la stratégie de guerre froide prônée par les Etats Unis. Il a fallu Gorbatchev en URSS pour ne pas comprendre que le ralliement à ce discours n’était porteur que de la catastrophe garantie.
Le nouveau discours « démocratique » allait donc porter ses fruits. Il est apparu comme suffisamment convaincant pour que les opinions de « gauche » en Europe s’y rallient. Non seulement les gauches électorales (des partis socialistes), mais tout également celles plus radicales à l’origine, dont les partis communistes étaient les héritiers. Avec « l’euro-communisme » le consensus devient général.
Les classes dominantes de la triade impérialiste ont tiré les leçons de leur victoire. Elles ont donc décidé de poursuivre cette stratégie de centrage du débat sur la « question démocratique ». On ne reproche pas à la Chine son ouverture économique extérieure, mais sa gestion politique monopolisée par le parti communiste. On ne tient pas compte des réalisations sociales de Cuba, sans pareilles dans toute l’Amérique latine, mais on ne cesse de stigmatiser son parti unique. Même à l’égard de la Russie de Poutine on tient le même discours.
L’objectif réel de cette stratégie est-il de faire triompher la démocratie ? Il faudrait être bien naïf pour le croire. Le seul objectif est d’imposer aux pays réfractaires « l’économie de marché », ouverte et intégrée dans le système mondial dit libéral, en réalité impérialiste et de soumettre les pays en question au statut de périphéries dominées dans ce système. Un objectif qui, réalisé, devient un obstacle au progrès de la démocratie dans les pays victimes concernés et en aucune manière un moyen d’avancer dans la réponse à la « question démocratique ».
Les chances d’avancées démocratiques dans les pays pratiquant, au moins à l’origine, le « socialisme réellement existant » auraient été bien meilleures, dans le moyen terme sinon dans l’immédiat, en laissant la dialectique des luttes sociales s’y développer par elle-même, ouvrant des perspectives possibles au dépassement des limites de l’héritage de ce « socialisme réellement existant » (de surcroît déformé par le ralliement au moins partiel à l’ouverture économique libérale), à la « sortie du tunnel ».
Au demeurant, le thème « démocratique » n’est invoqué que contre les pays récalcitrants à l’ouverture libérale mondialisée. Pour les autres, on est moins regardant à l’endroit de leur gestion politique parfaitement autocratique. L’Arabie saoudite, le Pakistan en donnent de beaux exemples. Mais tout également la Géorgie (pro-atlantiste) et beaucoup d’autres. Au mieux, d’ailleurs, la formule « démocratique » proposée ne dépasse guère les frontières de la caricature « pluripartiste électorale », non seulement parfaitement dissociée des exigences du progrès social, mais encore toujours – ou presque – associée à la régression sociale que la domination du capitalisme réellement existant (celui des oligopoles) exige et produit. La formule a déjà largement décrédibilisé la démocratie à laquelle les peuples en désarroi ont substitué l’adhésion à des illusions passéistes religieuses et ethnicistes.
Il est donc nécessaire plus que jamais de renforcer la critique de gauche radicale (je souligne radicale, pour la distinguer de la critique de gauche, confuse et vague). C'est-à-dire d’une critique qui associe et non dissocie démocratisation de la société (et pas seulement de sa pratique de gestion politique) et progrès social (dans une perspective socialiste). Dans cette critique la lutte pour la démocratisation et la lutte pour le socialisme sont indissociables. Pas de socialisme sans démocratie, mais aussi pas de progrès démocratique hors de la perspective socialiste.
« L’environnement », ou la perspective socialiste de la valeur d’usage ?
La question écologique et le développement prétendu durable
Là encore, le point de départ est la reconnaissance d’un problème vrai, celui de la destruction de l’environnement naturel et, en dernier ressort, la poursuite de la vie sur la Planète, produite par la logique de l’accumulation capitaliste. Là encore, l’émergence de la question remonte aux années 1970, plus exactement à la Conférence de Stockholm de 1972. Mais longtemps minoré, marginalisé dans la panoplie des discours dominants et des pratiques de la gestion de l’économie, cette question ne s’est imposée comme axe central nouveau de la stratégie dominante que relativement récemment. Plus tard donc, les travaux de Wackernagel et Rees (première publication anglaise, 1996), amorcent une réflexion majeure pour la pensée sociale radicale tournée vers la construction de l’avenir.(2)
Wackernagel et Rees n’ont pas seulement proposé un concept nouveau, celui de l’empreinte écologique. Ils ont élaboré un système de mesure de celle-ci et inventé à cet effet son unité définie en termes « d’hectare-global », confrontant la bio-capacité des sociétés/pays (leur capacité de produire et reproduire les conditions de la vie sur la planète) à la consommation par ces sociétés/pays des ressources mises à leur disposition par cette bio-capacité.
Les conclusions auxquelles les auteurs sont parvenus sont inquiétantes. A l’échelle de l’humanité, la bio-capacité de notre planète est de 2,1 hag par tête (soit, pour 6,3 milliards d’habitants, de 13,2 milliards hag). Par contre, la moyenne mondiale de la consommation de ces capacités était déjà – au milieu des années 1990 - de 2,7 hag. Cette « moyenne » masque une dispersion gigantesque, la moyenne pour les pays de la triade ayant déjà atteint un multiple (de l’ordre de quatre fois) de la moyenne mondiale. Une bonne partie de la bio-capacité des sociétés du Sud est captée par et au bénéfice des centres. Autrement dit, l’expansion du capitalisme réellement existant est destructrice de la Planète et de l’humanité et la poursuite de la logique de cette expansion exige soit un véritable génocide des peuples du Sud – « en trop » - soit au moins leur maintien dans une pauvreté appelée à s’aggraver sans cesse. Un courant écolo-fasciste se dessine qui donne légitimité à ce type de solution du problème.
L’intérêt de ces travaux va au-delà de leurs conclusions. Car il s’agit là d’un calcul (je dis bien calcul et non pas discours) tenu en termes de valeur d’usage des ressources de la Planète illustré par leur mesure en hectares-globaux (hag), pas en dollars.
La preuve est donc faite que la valeur d’usage sociale peut faire l’objet de calculs parfaitement rationnels. Cette preuve est décisive par sa portée, puisque le socialisme est défini en termes de société fondée sur la valeur d’usage et non la valeur d’échange. Et que les défenseurs du capitalisme–fin–de–l’histoire ont toujours tenu le socialisme pour une utopie irréaliste parce que – selon eux – la valeur d’usage ne serait pas mesurable, sauf à la confondre avec la valeur d’échange (fondée sur « l’utilité » dans l’économie vulgaire).
La prise en compte de la valeur d’usage (dont la mesure de l’empreinte écologique constitue un premier bel exemple) implique que le socialisme doit être « écologique », ne peut être qu’écologique comme le proclame Altvater –"Solar Socialism » or « no socialism » (3). Mais elle implique aussi que cette prise en compte est impossible dans un système capitaliste quelconque, même « réformé », comme on le verra plus loin.
Marx, en son temps, n’avait pas seulement soupçonné l’existence du problème en question. Il en avait déjà formulé l’expression de l’existence par la distinction rigoureuse qu’il faisait entre la valeur et la richesse, confondues par l’économie vulgaire. Marx dit explicitement que l’accumulation capitaliste détruit les bases naturelles sur lesquelles elle se fonde : l’homme (le travailleur aliéné et exploité, dominé et opprimé) et la terre (symbole de la richesse naturelle offerte à l’humanité). Et quelles que soient les limites de cette expression, prisonnière comme toujours de celles de l’époque, elle n’en demeure pas moins la manifestation d’une conscience lucide du problème (au-delà de l’intuition) qui mérite d’être reconnue.
Il est donc regrettable que les écologistes de notre époque, Wackernagel et Rees inclus, n’aient pas lu Marx. Cela leur aurait permis d’aller plus loin dans leurs propres propositions, d’en mieux saisir la portée révolutionnaire, et même, évidemment, d’aller plus loin que Marx lui-même sur ce sujet. Cette déficience de l’écologie moderne rend facile sa capture par l’idéologie de l’économie vulgaire en position dominante dans le monde contemporain. Cette capture est déjà en cours, et même bien avancée.
L’écologie politique (comme celle proposée par Alain Lipietz) se situait à l’origine dans l’éventail de la gauche politique, « pro-socialiste ». Par la suite les mouvements (puis partis) « verts » se sont classés dans le centre gauche, par l’expression de leurs sympathies envers la justice sociale et internationale, la critique du « gaspillage », la sensibilité au sort des travailleurs et des peuples « pauvres ». Mais, au-delà de la diversité de ces mouvements, on devra constater qu’aucun d’entre eux n’avait établi une relation rigoureuse entre la dimension socialiste authentique nécessaire en réponse au défi et celle de la prise en compte non moins nécessaire de sa dimension écologique. Pour y parvenir on ne peut pas faire l’impasse sur la distinction valeur/richesse qui trouve son origine chez Marx.
La capture de l’écologisme par l’idéologie vulgaire opère sur les deux plans : d’une part par la réduction du calcul en valeurs d’usage à un calcul en valeurs d’échange « amélioré », et d’autre part par l’intégration du défi écologique dans l’idéologie du « consensus ». L’une et l’autre de ces opérations annihilent la prise de conscience lucide qu’écologie et capitalisme sont antagoniques par nature.
La capture du calcul écologique par l’économie vulgaire avance à pas de géants. Des milliers de jeunes chercheurs, aux Etats Unis et par imitation en Europe, sont mobilisés à cet effet.
Les « coûts écologiques » sont, dans cet esprit, assimilés à des économies externes. La méthode vulgaire du calcul coûts/bénéfices, propre à la mesure de la valeur d’échange (elle-même confondue avec le prix du marché), est alors mobilisée pour définir un « prix juste » intégrant les économies et les déséconomies externes. Et le tour est joué.
Bien entendu, les travaux – fortement mathématisés – conduits dans le cadre de cette méthode traditionnelle de l’économie vulgaire ne disent pas comment le « prix juste » calculé pourrait devenir celui du marché réellement existant. On imagine donc que des « incitations », fiscales et autres, pourraient être suffisamment efficaces pour produire cette convergence. La preuve qu’il pourrait en être ainsi est absente.
En fait, on le voit déjà, les oligopoles se sont emparés de l’écologisme pour justifier l’ouverture de champs nouveaux à leur expansion destructrice. François Houtart en a donné une illustration décisive dans son ouvrage sur les agro carburants.(4) Le « capitalisme vert » est désormais l’objet des discours obligatoires des hommes/femmes de pouvoirs dans la triade (de droite et de gauche) et des dirigeants des oligopoles. L’écologisme en question est bien entendu conforme à la vision dite de la « soutenabilité faible » -jargon d’usage – (5), c'est-à-dire de la marchandisation des « droits à l’accès aux ressources de la planète ». Tous les économistes conventionnels se rallient ouvertement à cette position, en proposant « la mise aux enchères des ressources mondiales (pêche, permis de polluer …)». Une proposition qui revient tout simplement à soutenir les oligopoles dans leurs ambitions d’hypothéquer davantage l’avenir des peuples du Sud.
Cette capture du discours écologiste rend de beaux services à l’impérialisme. Car elle permet de marginaliser, pour ne pas dire simplement d’évacuer, la question du développement. Comme on le sait, la question du développement n’a été à l’ordre du jour de l’agenda international que lorsque les pays du Sud étaient en mesure de l’imposer par leurs initiatives propres, contraignant les puissances de la triade à négocier et faire des concessions. La page de l’ère de Bandoung tournée, il n’a plus été question de développement, mais seulement d’ouverture des marchés. Et l’écologie, entendue comme elle l’est par les pouvoirs dominants, vient à point pour prolonger cet état de fait.
La capture du discours écologiste par la culture politique du consensus (expression nécessaire de la conception du capitalisme–fin–de–l’histoire) n’est pas moins avancée. Cette capture emprunte la voie facile. Car elle répond aux aliénations et illusions dont se nourrit la culture dominante, qui est celle du capitalisme. Voie facile parce que cette culture existe réellement, est en place, et en place dominante dans l’esprit de la majorité des êtres humains, au Sud comme au Nord.
En contrepoint, l’expression des exigences de la contre culture du socialisme s’engage dans une voie difficile. Car la culture du socialisme n’est pas là, devant nous. Elle est futur à inventer, projet de civilisation, ouverte à l’imaginaire inventif. Des formules (comme « la socialisation par la démocratie et non par le marché » ; « la dominance de la culture substituée à celle de l’économique et de la politique à son service »), ne suffisent pas, en dépit de la puissance qu’elles ont pour amorcer le processus historique de la transformation. Car il s’agit d’un processus long, « séculaire », la reconstruction des sociétés sur d’autres principes que ceux du capitalisme tant au Nord qu’au Sud, ne pouvant être imaginée « rapide ». Mais la construction de l’avenir, même lointain, commence aujourd’hui.
L’économie conventionnelle, instrument idéologique central au service de la reproduction capitaliste
Le discours de l’économie conventionnelle qualifie le système en place « d’économie de marché », une qualification insuffisante et même trompeuse comme on l’a déjà dit plus haut, qui conviendrait pour décrire tout également l’Angleterre du XIXe siècle que la Chine des Sung et des Ming, ainsi que les villes italiennes de la Renaissance.
La théorie de « l’économie de marché » a toujours constitué la colonne vertébrale de « l’économie vulgaire », pour reprendre la qualification puissante que Marx en a déduit de sa critique radicale. La théorie en question évacue d’emblée et intégralement la réalité essentielle – les rapports sociaux de production (en particulier la propriété comme expression immédiate de ces rapports, érigée en principe sacralisée) – pour lui substituer l’hypothèse d’une société constituée « d’individus » (devenus de ce fait en dernière analyse les agents actifs de la reproduction du système et de son évolution). Ces « individus » (l’homo oeconomicus) sont anhistoriques, identiques à eux-mêmes depuis l’origine de l’humanité (Robinson), porteurs des mêmes qualités inchangées (l’égoïsme et la capacité de calculer et de faire des choix à son service). La construction bâtie sur ces fondements – « l’économie de marché » - ne correspond donc pas à une formulation stylisée du monde du capitalisme historique et réel. Il s’agit de la construction d’un système imaginaire qui n’intègre pratiquement rien d’essentiel de ce qui caractérise la réalité capitaliste.
La critique du Capital dévoile la nature idéologique (au sens fonctionnel du terme) de cette construction de l’économie vulgaire depuis Bastiat et Jean Baptiste Say, dont la fonction est simplement de légitimer l’ordre social en place, en l’assimilant à un « ordre naturel et rationnel ». Les théories ultérieures de la valeur – utilité et de l’équilibre économique général développées en réponse à Marx dans le troisième tiers du XIXe siècle et celles de leur héritier tardif, l’économie « mathématisée » contemporaine qualifiée de classique, néoclassique, libérale, néolibérale (ces qualifications n’importent pas), ne sortent pas du cadre défini par les principes fondamentaux de l’économie vulgaire.
Le discours de l’économie vulgaire conforte les exigences de la production et de la reproduction du capitalisme réellement existant. Il promeut, au-devant de la scène, l’éloge exclusif de la « compétition » considérée comme la condition incontournable du « progrès », qualité refusée à la solidarité (en dépit des témoignages de l’histoire), elle-même enfermée dans le corset étroit de la compassion et de la charité. Qu’il s’agisse de la concurrence entre « producteurs » (capitalistes, sans grande attention portée à la forme oligopolistique de la production capitaliste contemporaine), ou même entre « travailleurs » (ce qui suppose que le chômeur, ou le « pauvre », est responsable de sa situation). Le langage nouveau (« les partenaires sociaux » en lieu et place des classes en conflit) comme les pratiques –entre autre du Tribunal de l’Union Européenne farouche partisan du démantèlement des syndicats, obstacle à la concurrence entre travailleurs) – confortent l’exclusivité de la « compétition ».
A son tour, l’adoption du principe exclusif de la compétition invite la société à se rallier à l’objectif de la construction d’un « consensus » qui exclut, de la perspective, l’imaginaire d’une « autre société », fondée sur la solidarité. Cette idéologie de la société de consensus qui est désormais en passe d’être adoptée en Europe, annihile la portée transformatrice du message démocratique. Elle véhicule le message libertaire de droite qui considère l’Etat – quel qu’il soit – comme « l’ennemi de la liberté » (entendre l’ennemi de la liberté d’entreprise du capital). Elle dissocie la pratique de la démocratie castrée du progrès social.
Au-delà de l’économie vulgaire, les véritables problèmes du monde contemporain
L’économie vulgaire évacue tout simplement du champ de ses « analyses » les véritables questions majeures posées par le déploiement du capitalisme historique dans sa conquête du monde, des questions dont nous rappellerons brièvement la nature dans ce qui suit.
Au cœur du problème contemporain :
le capitalisme des oligopoles, généralisé, mondialisé et financiarisé
Le capitalisme est parvenu à un stade de centralisation et de concentration du capital sans commune mesure avec ce qu’il en était il y a seulement une cinquantaine d’années, et que je qualifie pour cette raison de capitalisme des oligopoles généralisé. Car, d’évidence, les « monopoles » (ou mieux les oligopoles) ne sont en aucune manière des inventions nouvelles dans l’histoire des temps modernes. Ce qui est par contre récent, nouveau, c’est le fait qu’un nombre limité et recensé d’oligopoles (« groupes »), de l’ordre de 500 si on ne retient que les plus gigantesques d’entre eux et 3 à 5 000 si on en dresse la liste quasi exhaustive, déterminent désormais seuls par leurs décisions l’ensemble de la vie économique de la planète, et davantage. Ce capitalisme des oligopoles généralisé constitue de ce fait un saut qualitatif dans l’évolution générale du capitalisme.
La raison retenue – et généralement la seule – pour rendre compte de cette évolution est que celle-ci est le produit nécessaire du progrès des technologies. Cela n’est que très partiellement vrai ; et encore faudrait-il préciser que l’invention technologique est elle-même commandée, dans une large mesure, par les exigences de sa mise au service de la concentration et du gigantisme. Pour de nombreuses productions, l’efficacité non seulement n’exige pas la gigantesque mais au contraire la « petite » et « moyenne » entreprise. Il en est ainsi, par exemple, pour la production agricole, où l’agriculture familiale moderne s’avère de loin la plus efficace. Mais il en est ainsi pour beaucoup d’autres productions de biens et services, néanmoins désormais soumis aux oligopoles qui en déterminent les conditions de la survie nécessaire.
La raison majeure véritable de ce processus se situe ailleurs : dans la recherche du profit maximal qui avantage les groupes puissants bénéficiaires de l’accès prioritaire exclusif aux marchés des capitaux. La concentration en question est toujours venue en réponse du capital aux crises longues et profondes qui ont marqué son histoire. Pour les temps récents, une première fois à la crise amorcée dans les années 1870, une seconde fois à celle amorcée un siècle exactement plus tard dans les années 1970.
La concentration en question est à l’origine de la « financiarisation » du système. Car celle-ci est le moyen par lequel les oligopoles parviennent à ponctionner, sur la plus value globale produite dans le système de production, une « rente de monopole » qui permet de relever dans des proportions considérables les taux de profit des groupes oligopolistiques concernés. Cette ponction est obtenue par l’accès exclusif des oligopoles aux marchés monétaires et financiers qui deviennent de ce fait les marchés dominants.
La « financiarisation » n’est donc en aucune manière le produit d’une dérive regrettable associée à la « dérégulation » des marchés financiers, encore moins « d’accidents » (comme les subprimes) sur lesquels l’économie vulgaire et le discours politique d’accompagnement concentrent l’attention. Elle est une exigence nécessaire à la reproduction du système des oligopoles généralisé. Autrement dit, tant qu’on ne remet pas en question le statut (« privé ») de ces oligopoles il est vain de parler de régulation » (audacieuse) des marchés financiers.
Le capitalisme des oligopoles généralisé et financiarisé est tout également mondialisé. Ici encore la « mondialisation » n’est par elle-même, en aucune manière, une caractéristique nouvelle du capitalisme, qui a toujours été « mondialisée ». Je suis même allé plus loin dans la qualification de la mondialisation capitaliste, et placé l’accent sur son caractère « polarisant » inhérent à sa nature (producteur du contraste croissant entre les centres « développés » du système et ses périphéries dominées), et ce à toutes les étapes de l’expansion capitaliste, du passé, du présent et du futur visible. J’ai tout également avancé la thèse que la phase nouvelle de la mondialisation était associée nécessairement à l’émergence d’un « impérialisme collectif de la triade » (Etats Unis, Europe, Japon).
La mondialisation nouvelle est elle-même indissociable du contrôle exclusif de l’accès aux ressources naturelles de la planète exercé par les pays de l’impérialisme collectif. De ce fait la contradiction centre/périphéries – le conflit Nord/Sud dans le langage courant – s’affirme comme centrale dans les transformations possibles du capitalisme réellement existant de notre époque. Et ce à un degré encore plus marqué que par le passé, qui exige à son tour l’exercice par le centre impérialiste collectif d’un « contrôle militaire de la planète ».
Les différentes « crises systémiques » observées et analysées – le caractère énergétivore des systèmes de production, la crise agricole et alimentaire, etc., – sont indissociables des exigences de la reproduction du capitalisme des oligopoles généralisé, financiarisé et mondialisé. En l’absence de remise en question du statut des oligopoles en question, les formulations de politiques adéquates pour donner une solution à ces « crises systémiques » - les formulations concernant le « développement durable » - demeurent des bavardages futiles.
Le capitalisme des oligopoles généralisé, financiarisé et mondialisé est devenu de ce fait un système « obsolète ». Dans le sens précis que la socialisation des oligopoles en question, c'est-à-dire l’abolition de leur statut privé, doit constituer désormais l’objectif stratégique incontournable dans l’analyse critique authentique du monde réel. En son absence, le système par lui-même ne peut produire que des effets destructifs de plus en plus barbares et criminels. Destruction de la planète elle-même peut être. Destruction des sociétés de la périphérie avec certitude, de celles des pays dits « émergents » comme de celles des pays « marginalisés ».
Le caractère obsolète du système parvenu au stade contemporain de son évolution est lui-même indissociable des transformations concernant l’architecture des classes dirigeantes (« bourgeoisies »), la pratique politique, l’idéologie et l’expression de la culture politique. La (ou les) bourgeoisie historique disparaît de la scène, remplacée désormais par la ploutocratie des « patrons » des oligopoles. La dérive de la pratique de la démocratie vidée de contenu, l’émergence d’expressions idéologiques ultra réactionnaires accompagnent nécessairement le caractère obsolète du capitalisme contemporain.
L’exercice de la domination des oligopoles opère dans la triade impérialiste centrale et dans les pays des périphéries du système dans des conditions et par des moyens différents. Cette différence est décisive, essentielle pour identifier les contradictions majeures du système et à partir de là imaginer les évolutions possibles du conflit Nord/Sud, appelé à prendre de l’ampleur.
La triade de l’impérialisme collectif rassemble les Etats Unis et leurs provinces extérieures (Canada et Australie), l’Europe occidentale et centrale, ainsi que le Japon. Les oligopoles mondialisés sont tous les produits de la concentration du capital national dans les pays qui constituent la triade. On reviendra plus loin sur les oligopoles nationaux des pays du Sud. Les pays de l’Europe orientale, même ceux qui appartiennent désormais à l’Union Européenne, ne disposent pas par eux-mêmes de leurs propres oligopoles « nationaux », et de ce fait ne constituent qu’un champ d’expansion pour les oligopoles de l’Europe occidentale (en particulier de l’Allemagne). Ils relèvent donc du statut de périphérie. Leur rapport asymétrique à l’Europe occidentale est mutatis mutandis analogue à celui qui lie l’Amérique latine aux Etats Unis (et accessoirement à l’Europe occidentale et au Japon).
Dans la triade, les oligopoles occupent toute la scène de la décision économique. Leur domination s’exerce directement sur toutes les entreprises gigantesques de production de biens et services comme sur les institutions financières (banques et autres) qui relèvent de leur pouvoir. Elle s’exerce indirectement sur l’ensemble des petites et moyennes entreprises (dans l’agriculture comme dans les autres domaines de la production), souvent réduites au statut de sous traitants, toujours soumises aux contraintes dans lesquelles les oligopoles les enferment en amont et en aval. Par ailleurs les oligopoles de la triade opèrent dans les pays des périphéries selon des modalités qu’on retrouvera plus loin.
Les oligopoles ne dominent pas seulement la vie économique des pays de la triade. Ils monopolisent à leur profit le pouvoir politique ; et les partis politiques électoraux (de droite et de gauche) sont devenus leurs débiteurs. Cette position est, pour l’avenir visible, acceptée comme « légitime » (en dépit de la dégradation de la démocratie qu’elle implique). Elle ne sera menacée que lorsque, dans un avenir plus lointain peut être, des « fronts anti-ploutocratiques » seront parvenus à mettre à l’ordre du jour l’abolition de la gestion privée des oligopoles et leur socialisation, dans des formes complexes et évolutives ouvertes.
Les formes et moyens de l’exercice du pouvoir des oligopoles dans les périphéries sont tout autre. Certes les délocalisations franches et les pratiques de sous-traitance en expansion ont donné aux oligopoles de la triade des pouvoirs d’intervention directe dans la vie économique des pays en question. Mais ceux-ci demeurent des pays indépendants dominés par des classes dirigeantes locales à travers lesquelles les oligopoles de la triade sont contraints d’opérer. L’éventail des formules d’opérations des rapports entre les oligopoles et les classes dirigeantes locales est largement ouvert. Ces formules vont de la pleine soumission directe de ces dernières, dans les pays « compradorisés » (« re-colonisés ») notamment dans les périphéries « marginalisées » (Afrique en particulier, mais pas exclusivement), à la négociation parfois difficile (avec concessions mutuelles obligatoires) – avec les classes dirigeantes, notamment des pays « émergents », Chine en premier lieu.
Il existe des oligopoles dans les pays du Sud. Cela a été le cas des grands ensembles publics dans les systèmes antérieurs du socialisme réellement existant (en Chine bien entendu, comme dans l’ex-Union Soviétique, mais aussi à une échelle de taille plus modeste à Cuba et au Viet Nam). Cela a été le cas en Inde, au Brésil et ailleurs dans le Sud « capitaliste » : certains de ces oligopoles ayant le statut public ou semi public, d’autres privés. Avec l’approfondissement de la mondialisation, certains de ces oligopoles (publics ou privés) ont amorcé leur intervention hors de leurs frontières, et reproduit les méthodes mises en œuvre par les oligopoles de la triade. Néanmoins les interventions des oligopoles du Sud hors de leurs frontières demeurent – et demeureront pour longtemps – marginales comparativement à celles du Nord. Par ailleurs les oligopoles du Sud n’ont pas capté à leur profit exclusif le pouvoir politique dans leurs pays respectifs. En Chine la statocratie du Parti-Etat constitue toujours le noyau essentiel du pouvoir. En Russie le mix Etat-oligarchies privées a restitué à l’Etat un pouvoir autonome perdu un moment après l’effondrement de l’URSS. En Inde, au Brésil et dans d’autres pays du Sud le poids de l’oligarchie privée n’est pas exclusif : le pouvoir est assis sur des blocs hégémoniques plus larges, intégrant notamment des bourgeoisies nationales, des classes moyennes, des propriétaires latifundiaires modernisés, des paysans riches.
L’ensemble de ces conditions réelles interdit de confondre l’Etat dans la triade (au service exclusif de l’oligarchie et toujours légitime) et l’Etat dans les périphéries. Celui-ci ne bénéficie jamais du même degré de légitimité que dans les centres, et peut parfaitement perdre intégralement celle-ci. Les pouvoirs en place, tels qu’ils sont, demeurent de ce fait fragiles, vulnérables aux luttes sociales et politiques.
L’hypothèse que cette vulnérabilité serait « transitoire » et appelée à s’atténuer avec le développement du capitalisme local lui-même inscrit dans la mondialisation, qui procède de la vision linéaire des « étapes du développement » (formulée par Rostow en 1960) est indiscutablement erronée, même pour les pays « émergents ». Mais la pensée conventionnelle et l’économie vulgaire ne sont pas équipées intellectuellement pour comprendre que le « rattrapage » dans le système est impossible, que l’écart centres/périphéries n’est pas appelé à s’effacer « graduellement ».
Les oligopoles et les pouvoirs politiques à leur service dans les pays de la triade poursuivent l’objectif exclusif de « sortir de la crise financière » et de restaurer le système tel qu’il était pour l’essentiel. Il y a de bonnes raisons de penser que cette restauration – en cas de succès, ce qui n’est pas impossible quoique plus difficile qu’on ne le pense généralement – ne pourrait être durable, car elle implique la remise en route de l’expansion financière, moyen incontournable pour les oligopoles de capter à leur profit une rente de monopole. Un nouvel effondrement financier, encore plus fracassant que celui de 2008, serait donc probable. Mais au-delà même de ces considérations, la restauration du système, destinée à permettre la reprise de l’expansion du champ des activités des oligopoles, impliquerait l’aggravation des processus d’accumulation par dépossession des peuples du Sud (par la capture de leurs ressources naturelles, y compris de leurs terres agricoles). Et les discours écologistes concernant « le développement durable » ne pèseront pas lourd face aux logiques de l’expansion des oligopoles, tout à fait capables de paraître les « adopter » dans leur rhétorique comme on le voit déjà.
Les victimes principales de cette « reprise » seraient les nations du Sud, pays « émergents » et autres. Dans ces conditions on peut imaginer que les « conflits Nord/Sud » sont appelés à prendre beaucoup d’ampleur dans les années à venir. Les réponses que le « Sud » donnera à ces défis pourraient alors constituer l’axe majeur de la remise en question du système mondialisé. Une remise en question qui n’est pas directement celle du « capitalisme », mais qui est assurément celle de la mondialisation commandée par la domination des oligopoles.
La substance de ces réponses du Sud devrait donc être précisée dans une perspective de contribution à armer les peuples et les Etats du Sud face à l’agression des oligopoles de la triade, faciliter leur « déconnexion » relative par rapport au système de la mondialisation en place, promouvoir des alternatives de coopération Sud-Sud multiples et conséquentes.
La remise en question du statut privatif des oligopoles par les peuples du Nord eux-mêmes (le « front antiploutocratique ») constitue certes l’objectif stratégique incontournable des luttes pour l’émancipation des travailleurs et des peuples. Mais la maturation politique de cet objectif demeure malheureusement distante, peu probable dans l’avenir visible. Et de ce fait les conflits Nord/Sud sont appelés probablement à occuper le devant de la scène.
Le capitalisme, une parenthèse dans l’histoire
Le principe de l’accumulation sans fin qui définit le capitalisme est synonyme de croissance exponentielle, et celle-ci, comme le cancer, conduit à la mort. Stuart Mill, qui l’avait compris, imaginait qu’un « état stationnaire » mettrait un terme à ce processus irrationnel. Keynes partageait cet optimisme de la Raison. Mais ni l’un ni l’autre n’était équipé pour comprendre comment le dépassement nécessaire du capitalisme pourrait s’imposer. Marx, en donnant toute sa place à la nouvelle lutte des classes, pouvait par contre imaginer le renversement du pouvoir de la classe capitaliste, concentré aujourd’hui dans les mains de l’oligarchie.
L’accumulation, synonyme également de paupérisation, dessine le cadre objectif des luttes contre le capitalisme. Mais celle-ci s’exprime principalement par le contraste grandissant entre l’opulence des sociétés du centre, bénéficiaires de la rente impérialiste et la misère de celles des périphéries dominées. Ce conflit devient de ce fait l’axe central de l’alternative «socialisme ou barbarie ».
Le capitalisme historique "réellement existant" est associé à des formes successives d’accumulation par dépossession, non pas seulement à l’origine (« l’accumulation primitive ») mais à toutes les étapes de son déploiement. Une fois constitué, ce capitalisme « atlantique » est parti à la conquête du monde et l’a refaçonné sur la base de la permanence de la dépossession des régions conquises, devenant de ce fait les périphéries dominées du système. (6)
Cette mondialisation « victorieuse » a prouvé être incapable de s’imposer d’une manière durable. Un demi siècle à peine après son triomphe, qui pouvait déjà paraître inaugurer la « fin de l’histoire », elle était déjà remise en cause par la révolution de la semi périphérie russe et les luttes (victorieuses) de libération de l’Asie et de l’Afrique qui ont fait l’histoire du XXe siècle – la première vague de luttes pour l’émancipation des travailleurs et des peuples.
L'accumulation par dépossession se poursuit sous nos yeux dans le capitalisme tardif des oligopoles contemporains. Dans les centres, la rente de monopole dont bénéficient les ploutocraties oligopolistiques est synonyme de dépossession de l'ensemble de la base productive de la société. Dans les périphéries, cette dépossession paupérisante se manifeste par l'expropriation des paysanneries et par le pillage des ressources naturelles des régions concernées. L'une et l'autre de ces pratiques constituent les piliers essentiels des stratégies d'expansion du capitalisme tardif des oligopoles.
Dans cet esprit, je place la « nouvelle question agraire » au cœur du défi pour le XXIe siècle. La dépossession des paysanneries (d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine) constitue la forme majeure contemporaine de la tendance à la paupérisation (au sens que Marx donne à cette « loi ») associée à l’accumulation. Sa mise en œuvre est indissociable des stratégies de captation de la rente impérialiste par les oligopoles, avec ou sans agro carburants. J'en déduis que le développement des luttes sur ce terrain, les réponses qui seront données à travers elles à l’avenir des sociétés paysannes du Sud (presque la moitié de l’humanité) commanderont largement la capacité ou non des travailleurs et des peuples à produire des avancées sur la route de la construction d'une civilisation authentique, libérée de la domination du capital, pour laquelle je ne vois pas d'autre nom que celui du socialisme.(7)
Le pillage des ressources naturelles du Sud qu'exige la poursuite du modèle de consommation gaspilleuse au bénéfice exclusif des sociétés opulentes du Nord annihile toute perspective de développement digne de ce nom pour les peuples concernés et constitue de ce fait l'autre face de la paupérisation à l'échelle mondiale. Dans cet esprit la « crise de l’énergie » n’est pas le produit de la raréfaction de certaines des ressources nécessaires à sa production (le pétrole bien entendu), ni davantage le produit des effets destructeurs des formes énergétivores de production et de consommation en vigueur. Cette description – correcte – ne va pas au-delà des évidences banales et immédiates. Cette crise est le produit de la volonté des oligopoles de l’impérialisme collectif de s’assurer le monopole de l’accès aux ressources naturelles de la planète, que celles-ci soient rares ou pas, de manière à s’approprier la rente impérialiste, quand bien même l’utilisation de ces ressources demeurerait ce qu’elle est (gaspilleuse, énergétivore) ou serait soumise à des politiques « écologistes » correctives nouvelles. J'en déduis également que la poursuite de la stratégie d'expansion du capitalisme tardif des oligopoles se heurtera nécessairement à la résistance grandissante des nations du Sud.
D’une longue crise à l’autre
La crise actuelle n’est ni une crise financière, ni la somme de crises systémiques multiples, mais la crise du capitalisme impérialiste des oligopoles, dont le pouvoir exclusif et suprême risque d’être remis en question, cette fois encore, à la fois par les luttes de l'ensemble des classes populaires et par celles des peuples et nations des périphéries dominées, fussent elles en apparence « émergentes ». Elle est simultanément une crise de l'hégémonie des Etats-Unis. Capitalisme des oligopoles, pouvoir politique des oligarchies, mondialisation barbare, financiarisation, hégémonie des Etats-Unis, militarisation de la gestion de la mondialisation au service des oligopoles, déclin de la démocratie, pillage des ressources de la planète, abandon de la perspective du développement du Sud sont indissociables.
Le vrai défi est donc le suivant : ces luttes parviendront-elles à converger pour ouvrir la voie – ou des voies – sur la longue route à la transition au socialisme mondial ? Ou demeureront-elles séparées les unes des autres, voire entreront-elles en conflit les unes contre les autres, et de ce fait, inefficaces, laissant l’initiative au capital des oligopoles ?
Il est bon de revenir sur la première longue crise du capitalisme, qui a façonné le XXe siècle, tant le parallèle entre les étapes du développement de ces deux crises est saisissant.
Le capitalisme industriel triomphant du XIXe siècle entre en crise à partir de 1873. Les taux de profits s’effondrent, pour les raisons mises en évidence par Marx. Le capital réagit par un double mouvement de concentration et d’expansion mondialisée. Les nouveaux monopoles confisquent à leur profit une rente prélevée sur la masse de la plus value générée par l’exploitation du travail. Ils accélèrent la conquête coloniale de la planète. Ces transformations structurelles permettent un nouvel envol des profits. Elles ouvrent la « belle époque » - de 1890 à 1914 – qui est celle d’une domination mondialisée du capital des monopoles financiarisés. Les discours dominants de l’époque font l’éloge de la colonisation (la « mission civilisatrice »), qualifient la mondialisation de synonyme de paix, et la social démocratie ouvrière européenne se rallie à ce discours.
Pourtant la « belle époque », annoncée comme la « fin de l’histoire » par les idéologues en vue de l’époque, se termine par la guerre mondiale, comme seul Lénine l’avait vu. Et la période qui suit pour se poursuivre jusqu’aux lendemains de la seconde guerre mondiale sera celle de « guerres et révolutions ». En 1920, la révolution russe (le « maillon faible » du système) ayant été isolée, après la défaite des espoirs de révolution en Europe centrale, le capital des monopoles financiarisés restaure contre vents et marées le système de la « belle époque ». Une restauration, dénoncée par Keynes à l'époque, qui est à l’origine de l’effondrement financier de 1929 et de la dépression qu’elle va entraîner jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Le « long XXe siècle » - 1873/1990 – est donc à la fois celui du déploiement de la première crise systémique profonde du capitalisme vieillissant (au point que Lénine pense que ce capitalisme des monopoles constitue la « phase suprême du capitalisme »), et celui d’une première vague triomphante de révolutions anti capitalistes (Russie, Chine) et de mouvements anti impérialistes des peuples d’Asie et d’Afrique.
La seconde crise systémique du capitalisme s’ouvre en 1971, avec l’abandon de la convertibilité or du dollar, presque exactement un siècle après le début de la première. Les taux de profit, d’investissement, et de croissance s’effondrent (ils ne retrouveront jamais depuis les niveaux qui avaient été les leurs de 1945 à 1975). Le capital répond au défi comme dans la crise précédente par un double mouvement de concentration et de mondialisation. Il met ainsi en place des structures qui définiront la seconde « belle époque » (1990/2008) de mondialisation financiarisée permettant aux groupes oligopolistiques de prélever leur rente de monopole. Mêmes discours d’accompagnement : le « marché » garantit la prospérité, la démocratie et la paix ; c’est la « fin de l’histoire ». Mêmes ralliements des socialistes européens au nouveau libéralisme. Et pourtant cette nouvelle « belle époque » s’est accompagnée dés le début par la guerre, celle du Nord contre le Sud, amorcée dés 1990. Et tout comme la première mondialisation financiarisée avait donné « 1929 », la seconde a produit « 2008 ».
Nous sommes parvenus aujourd’hui à ce moment crucial qui annonce la probabilité d’une nouvelle vague de « guerres et révolutions ». D’autant que les pouvoirs en place n’envisagent rien d’autre que la restauration du système tel qu’il était avant son effondrement financier.
L’analogie entre les développements de ces deux crises systémiques longues du capitalisme vieillissant est frappante. Il y a néanmoins des différences dont la portée politique est importante.
(La suite dans notre prochaine édition)
NOTES
1 Jacques Andreani, Le Piège, Helsinki et la chute du communisme; Odile Jacob, Paris 2005
2 Mathis Wackernagel et William Rees, Notre empreinte écologique; Ecosociété, Montréal, 1999
3 Elmar Altvater, The plagues of capitalism, energy crisis, climate collapse, hunger and financial Instabilities, papier présenté au FMA, Caracas 2008
4 François Houtart, L'agroénergie, solution pour le climat ou sortie de crise pour le capital?; Couleur Livres, Charleroi 2009
5 Aurélien Bontaud et Natacha Gondran, L'empreinte écologique; La Découverte, Paris 2009
Les auteurs font la distinction entre l'écologie authentique et sa récupération marchande (la "soutenabilité faible").
6 Giovanni Arrighi, The long XXth century; Verso, London, 1994
Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing
Le concept d'accumulation par dépossession, introduit par Arrighi, comme celui d'"accumulation primitive permanente" que je proposais, caractérise le capitalisme historique, européen d'origine, par opposition à l'autres voie de développement vers le capitalisme, inaugurée par la Chine des Sung et des Mings. (Correspondance Arrighi/Amin).
Voir également, Samir Amin, Sur la crise, op cit chap 2 et 3.
7 Référence aux travaux de Samir Amin, Sam Moyo, Archie Mafeje et autres dans :
Samir Amin, Sur la crise, op cit chap 5.
* Samir Amin dirige le Forum pour le développement du Tiers-Monde – Le titre original du texte est : «Les champs de bataille de l’impérialisme contemporain et les conditions d'une réponse efficace du Sud»
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 691 lectures