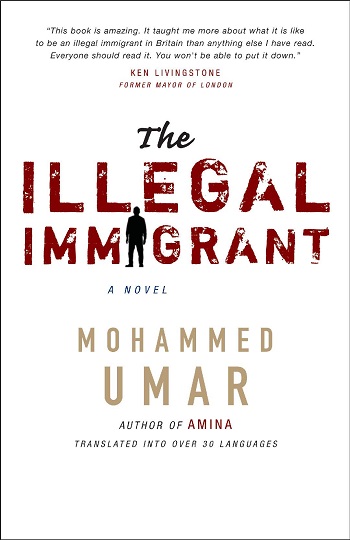Samir Amin rappelle ce que Marx disait de l’accumulation capitaliste. A savoir qu’il détruit les bases naturelles sur lesquelles elle se fonde : l’homme (le travailleur aliéné et exploité, dominé et opprimé) et la terre (symbole de la richesse naturelle offerte à l’humanité). Derrière les limites expression, «prisonnière comme toujours de celles de l’époque», l’auteur lui trouve une pertinence toujours actuelle. Pour dire que les écologistes d’aujourd’hui ont cette limite qui tient au fait qu’il n’ont pas lu Marx. «Cela leur aurait permis d’aller plus loin dans leurs propres propositions, d’en mieux saisir la portée révolutionnaire, et même, évidemment, d’aller plus loin que Marx lui-même sur ce sujet», analyse-t-il.
Les travaux de Wackernagel et Rees (première publication anglaise, 1996), amorcent une réflexion majeure pour la pensée sociale radicale tournée vers la construction de l’avenir. Les auteurs n’ont pas seulement proposé un concept nouveau, celui de l’empreinte écologique. Ils ont élaboré un système de mesure de celle-ci et inventé à cet effet son unité définie en termes « d’hectare-global » (HAG), confrontant la bio-capacité des sociétés/pays (leur capacité de produire et reproduire les conditions de la vie sur la planète) à la consommation par ces sociétés/pays des ressources mises à leur disposition par cette bio-capacité.
Les conclusions auxquelles les auteurs sont parvenus sont inquiétantes. A l’échelle de l’humanité la bio-capacité de notre planète est de 2,1 HAG par tête (soit pour 6,3 milliards d’habitants de 13,2 milliards HAG). Par contre la moyenne mondiale de la consommation de ces capacités était déjà – au milieu des années 1990- de 2,7 HAG. Cette « moyenne » masque une dispersion gigantesque, la moyenne pour les pays de la triade ayant déjà atteint un multiple (de l’ordre de 4 fois) de la moyenne mondiale. Une bonne partie de la bio-capacité des sociétés du Sud est captée par et au bénéfice des centres. Autrement dit l’expansion du capitalisme réellement existant est destructeur de la Planète et de l’humanité et la poursuite de la logique de cette expansion exige soit un véritable génocide des peuples du Sud – « en trop » - au moins, soit leur maintien dans une pauvreté appelée à s’aggraver sans cesse. Un courant écolo-fasciste se dessine qui donne légitimité à ce type de solution du problème.
L’intérêt de ces travaux va au-delà de leurs conclusions. Car il s’agit là d’un calcul (je dis bien calcul et non pas discours) tenu en termes de la valeur d’usage des ressources de la Planète illustré par leur mesure en hectares-globaux (hag), pas en dollars.
La preuve est donc faite que la valeur d’usage sociale peut faire l’objet de calculs parfaitement rationnels. Cette preuve est décisive par sa portée puisque le socialisme est défini en termes de société fondée sur la valeur d’usage et non la valeur d’échange. Et que les défenseurs du capitalisme–fin–de–l’histoire ont toujours tenu le socialisme pour une utopie irréaliste parce que – selon eux – la valeur d’usage ne serait pas mesurable, sauf à la confondre avec la valeur d’échange (fondée sur « l’utilité » dans l’économie vulgaire).
La prise en compte de la valeur d’usage (dont la mesure de l’empreinte écologique constitue un premier bel exemple) implique que le socialisme doit être « écologique », ne peut être qu’écologique comme le proclame Altvater (« Solar Socialism » or « no socialism »). Mais elle implique aussi que cette prise en compte est impossible dans un système capitaliste quelconque, même « réformé », comme on le verra plus loin.
Marx, en son temps, n’avait pas seulement soupçonné l’existence du problème en question. Il en avait déjà formulé l’expression de l’existence par la distinction rigoureuse qu’il faisait entre la valeur et la richesse, confondues par l’économie vulgaire. Marx dit explicitement que l’accumulation capitaliste détruit les bases naturelles sur lesquelles elle se fonde : l’homme (le travailleur aliéné et exploité, dominé et opprimé) et la terre (symbole de la richesse naturelle offerte à l’humanité). Et quelles que soient les limites de cette expression, prisonnière comme toujours de celles de l’époque, elle n’en demeure pas moins la manifestation d’une conscience lucide du problème (au-delà de l’intuition) qui mérite d’être reconnue.
Il est donc regrettable que les écologistes de notre époque, Wackernagel et Rees inclus, n’aient pas lu Marx. Cela leur aurait permis d’aller plus loin dans leurs propres propositions, d’en mieux saisir la portée révolutionnaire, et même, évidemment, d’aller plus loin que Marx lui-même sur ce sujet.
Cette déficience de l’écologie moderne facilite sa capture par l’idéologie de l’économie vulgaire en position dominante dans le monde contemporain. Cette capture est déjà en cours, et même bien avancée.
L’écologie politique (comme celle proposée par Alain Lipietz) se situait à l’origine dans l’éventail de la gauche politique, « pro-socialiste ». Par la suite, les mouvements (puis partis) « verts » se sont classés dans le centre gauche, par l’expression de leurs sympathies envers la justice sociale et internationale, la critique du « gaspillage », la sensibilité au sort des travailleurs et des peuples « pauvres ». Mais, au-delà de la diversité de ces mouvements, on devra constater qu’aucun d’entre eux n’avait établi une relation rigoureuse entre la dimension socialiste authentique nécessaire en réponse au défi et celle de la prise en compte non moins nécessaire de sa dimension écologique. Pour y parvenir, on ne peut pas faire l’impasse sur la distinction valeur/richesse qui trouve son origine chez Marx.
La capture de l’écologisme par l’idéologie vulgaire opère sur les deux plans : d’une part par la réduction du calcul en valeurs d’usage à un calcul en valeurs d’échange « amélioré », et d’autre part par l’intégration du défi écologique dans l’idéologie du « consensus ». L’une et l’autre de ces opérations annihilent la prise de conscience lucide qu’écologie et capitalisme sont antagoniques par nature.
La capture du calcul écologique par l’économie vulgaire avance à pas de géants. Des milliers de jeunes chercheurs, aux Etats Unis et par imitation en Europe, sont mobilisés à cet effet.
Les « coûts écologiques » sont, dans cet esprit, assimilés à des économies externes. La méthode vulgaire du calcul coûts/bénéfices propre à la mesure de la valeur d’échange (elle-même confondue avec le prix du marché) est alors mobilisée pour définir un « prix juste » intégrant les économies et les déséconomies externes. Et le tour est joué.
Bien entendu les travaux – fortement mathématisés – conduits dans le cadre de cette méthode traditionnelle de l’économie vulgaire ne disent pas comment le « prix juste » calculé pourrait devenir celui du marché réellement existant. On imagine donc que des « incitations », fiscales et autres, pourraient être suffisamment efficaces pour produire cette convergence. La preuve qu’il pourrait en être ainsi est absente.
En fait, on le voit déjà, les oligopoles se sont emparés de l’écologisme pour justifier l’ouverture de champs nouveaux à leur expansion destructrice. François Houtart en a donné une illustration décisive dans son ouvrage sur les agro carburants. Le « capitalisme vert » est désormais l’objet des discours obligatoires des hommes/femmes de pouvoirs dans la triade (de droite et de gauche) et des dirigeants des oligopoles. L’écologisme en question est bien entendu conforme à la vision dite de la « soutenabilité faible » (jargon d’usage), c'est-à-dire de la marchandisation des « droits à l’accès aux ressources de la planète ». Dans le rapport de la Commission des Nations Unies qu’il avait présidé, présenté à l’Assemblée Générale des Nations Unies réunie du 24 au 26 juin 2009, Stiglitz se rallie ouvertement à cette position, en proposant « la mise aux enchères des ressources mondiales (pêche, permis de polluer …)». Une proposition qui revient tout simplement à soutenir les oligopoles dans leurs ambitions d’hypothéquer davantage l’avenir des peuples du Sud.
La capture du discours écologiste par la culture politique du consensus (expression nécessaire de la conception du capitalisme – fin – de – l’histoire) n’est pas moins avancée.
Cette capture emprunte la voie facile. Car elle répond aux aliénations et illusions dont se nourrit la culture dominante, qui est celle du capitalisme. Voie facile parce que cette culture existe réellement, est en place, et en place dominante dans l’esprit de la majorité des êtres humains, au Sud comme au Nord.
En contrepoint l’expression des exigences de la contre culture du socialisme engage dans une voie difficile. Car la culture du socialisme n’est pas là, devant nous. Elle est futur à inventer, projet de civilisation, ouverte à l’imaginaire inventif. Des formules (comme « la socialisation par la démocratie et non par le marché » ; « la dominance de la culture substituée à celle de l’économique et de la politique à son service »), ne suffisent pas, en dépit de la puissance qu’elles ont pour amorcer le processus historique de la transformation. Car il s’agit d’un processus long, « séculaire », la reconstruction des sociétés sur d’autres principes que ceux du capitalisme tant au Nord qu’au Sud, ne pouvant être imaginée « rapide ». Mais la construction de l’avenir, même lointain, commence aujourd’hui.
* Samir Amin est directeur du Forum du Tiers-Monde
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 656 lectures