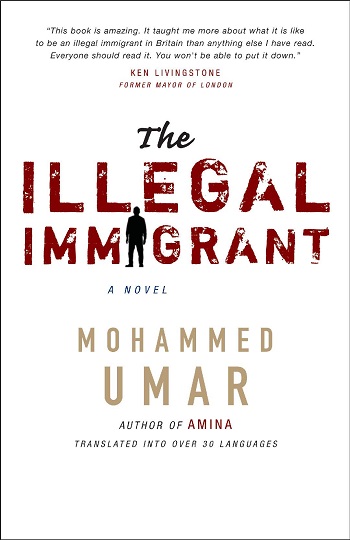En prévision d’une réunion pour élaborer des stratégies de sortie de la crise économique internationale, prévue juin 2009, l’Organisation des Nations unies, avait chargé une commission présidée par Joseph Stiglitz, d’élaborer des propositions. Dans une lecture critique du rapport présenté à cette occasion, Samir Amin établit qu’il occulte certaines considérations essentielles dans le fondement de la crise actuelle et n’offre aucune perspective de décision autonome pour les pays du Sud et de possibilités réelles des solutions face aux problèmes qui leur sont posés. En définitive, note M. Amin, le lauréat du Prix Nobel d’économie est resté ce qu’il était – un fonctionnaire de la Banque Mondiale à laquelle il n’a jamais adressé que des critiques mineures. Or, pour lui, «le monde est engagé sur le chemin d’un chaos toujours grandissant» et «la meilleure réponse alternative passe par le renforcement des chances d’une reconquête de l’autonomie du Sud».
L’examen exhaustif des propositions du rapport Stiglitz est un exercice fastidieux d’intérêt discutable. Car dans leur ensemble, ces propositions ne diffèrent pas de celles produites par la profession des économistes conventionnels libéraux orthodoxes, à l’exception des extrémistes du libéralisme dogmatique devenus minoritaires.
Dans cette analyse, la crise en cours serait une crise conjoncturelle provoquée par les excès dans l’expansion du crédit, même si on accepte qu’elle soit accompagnée de « problèmes structurels » sous jacents particuliers. Il s’agit donc d’une crise en V, dont la reprise rapide est possible. La croissance qui doit reprendre restera dynamisée par l’expansion financière, comme elle l’était avant l’effondrement de 2008. Les seules précautions à prendre sont destinées à éviter à l’avenir les dérives de cette expansion.
Dans sa dimension mondialisée le système doit reprendre sa croissance dans le même cadre libéral « ouvert » qui le caractérise depuis trois décennies, et éviter les réponses « protectionnistes » aux difficultés du moment, passagères.
Proche de la vision de la CIA exprimée dans son rapport « Le monde en 2010 » (dont j’ai proposé une lecture critique ailleurs), le rapport Stiglitz n’envisage pas de « bouleversements », mais seulement un poids commercial plus important de la Chine et des autres pays émergents.
Cette évolution pourrait être facilitée par – et faciliter à son tour – l’abandon progressif de la référence exclusive au dollar comme monnaie de réserve internationale. La réforme du système devrait se donner cet objectif.
Le rapport Stiglitz s’est donné apparemment des objectifs généreux, comme celui « d’améliorer le fonctionnement de l’économie mondiale pour le bien de tous les habitants de la planète », sans omettre la poursuite « des idéaux lointains de la croissance durable » etc.
Mais il ne s’agit là, sans doute, que des clauses de style incontournables. Aucun rapport de l’ONU ou d’un gouvernement quelconque ne prétendra poursuivre d’autres objectifs.
Dans deux directions, néanmoins, le rapport Stiglitz, proclame une intention d’aller plus loin que les libéraux extrémistes.
Il affirme en effet nécessaire « d’agir pour résoudre les problèmes structurels sous jacents » ; il « reconnaît que les marchés agissant souverainement ne sont pas par eux-mêmes auto correcteurs ».
Une première série de questions concerne donc les problèmes « structurels » mentionnés. Quels sont-ils, comment sont-ils conçus et analysés ? Quels sont les politiques proposées pour répondre aux défis qu’ils constituent ? Mais tout également : quels sont les « problèmes structurels » que le rapport ne mentionne pas.
La seconde série de questions concernent les correctifs proposés aux divagations du marché.
Les « questions écologiques » constituent un premier ensemble des « problèmes structurels » considérés. Il est devenu en effet impossible de les ignorer et il n’existe plus de pouvoir politique qui le fasse. Mais dans ce domaine comme dans les autres Stiglitz, ne se démarque pas de l’orthodoxie libérale et ses propositions annihilent de fait toute considération sérieuse de ces questions.
En fait les « problèmes structurels » considérés dans le rapport excluent les deux grandes familles de questions qui définissent le défi majeur auquel le système contemporain est confronté.
La première de ces familles concerne l’organisation de la production et du travail. Il n’est fait nulle part référence dans le rapport, même pas une simple allusion, à la « crise (fin) du fordisme » par exemple qui est pourtant à l’origine de la crise longue de trois décennies et sans la considération de laquelle la faillite de l’industrie automobile – entre autre – reste sans explication. Ignorer la crise structurelle de l’accumulation fordiste c’est se condamner à ne pas comprendre comment celle-ci créait les conditions d’une offensive contre le travail et pourquoi la financiarisation en a été précisément le moyen. Mais comme on l’a déjà dit, Stiglitz, avec les autres économistes orthodoxes libéraux, ne sont pas équipés pour intégrer ces questions dans leur « économique des marchés ».
La seconde famille des questions ignorées concerne le statut et la gestion des entreprises (du capital). L’existence même des groupes oligopolistiques n’est prise en considération qu’à travers les propos insignifiants du rapport invitant à la « révision de la gouvernance d’entreprise » ! Pourtant, face aux positions libérales orthodoxes de droite (en fait tout à fait réactionnaires) de Stiglitz, un large éventail de l’opinion publique est déjà conscient de la nécessité de remettre en question la gestion privative de ces groupes. J’en donne l’exemple de la profession des médecins qui, dans son ensemble, conçoit sans difficulté la nécessité de soumettre la gestion des industries pharmaceutiques aux impératifs de la satisfaction des besoins sociaux, voire pour le faire de les nationaliser.
Une autre série de « grandes » questions concerne évidemment les distances qui séparent, dans le système mondialisé, les « pays développés » (le Nord) de ceux « en voie de développement » (le Sud). Dans un rapport de l’ONU comme dans un rapport quelconque se situant dans le cadre de considérations sur la mondialisation, cette distinction ne peut pas être « oubliée ». Mais comme on le verra plus loin, ici également, les propositions de Stiglitz ne sortent pas de la vision simpliste du « développement par étapes » (Rostow) du libéralisme orthodoxe qui, en fait, ignore la question.
L’orthodoxie libérale ne peut rien proposer de véritablement sérieux et efficace concernant la « régulation des marchés ». D’ailleurs dans ce domaine le rapport Stiglitz se situe en deçà de nombreux travaux conduits dans le cadre de l’économie conventionnelle.
Les propositions de Stiglitz dans ce domaine ne concernent pratiquement que la « gestion des risques financiers » (pages 14 et suivantes). La question de fond, qui est celle de savoir si la croissance « dynamisée par la finance» est une forme viable ou si au contraire elle est la réponse à une crise de l’accumulation, est tout simplement ignorée. Stiglitz est, avec les libéraux orthodoxes de droite, convaincu que le système de la croissance des deux décennies qui ont précédé l’effondrement de 2008 était fondamentalement « sain » et que par conséquent quelques améliorations concernant « la gestion des risques financiers » constituent l’essentiel de ce qu’il « faut faire ».
Ces risques sont d’ailleurs gérés en fait par les oligopoles eux-mêmes et singulièrement leurs instruments d’intervention sur les marchés financiers. Stiglitz, comme les gouvernements du G7, ne remet pas en question ce « droit ». Il confie donc aux groupes concernés eux-mêmes la responsabilité de s’auto-corriger.
Encore doit-on dire que la lecture du rapport surprend pas la timidité – presque l’insignifiance – des propositions et révèle l’attachement farouche de Stiglitz à tous les préjugés concernant la « supériorité » du modèle « anglo saxon ». Par exemple Stiglitz défend le principe de la « comptabilité aux prix du marché » (le modèle des Etats Unis) et sans doute tient le principe de « la comptabilité aux prix historiques » de la tradition européenne pour stupide. Qu’il soit nécessaire, au contraire, que le principe étatsunien, qui offre des facilités aux mouvements spéculatifs de grande ampleur, soit remis en question, n’effleure pas son esprit. Et sans doute méprise-t-il ses nombreux collègues libéraux orthodoxes qui ne partagent pas son opinion (qui est plutôt celle des brokers de Wall Street que celle des économistes conventionnels sérieux).
On ne sera donc pas surpris que les propositions d’un retour à la séparation entre les banques commerciales et les banques d’investissement ne soit pas considérée sérieusement par Stiglitz. Encore devrait-on savoir que cette séparation – parfaitement justifiée par de nombreux économistes libéraux – risquerait fort d’être peu efficace, parce que les deux institutions concernées (la banque commerciale et la banque d’investissement aujourd’hui fusionnées, demain à nouveau séparées juridiquement), si elles appartiennent au même groupe oligopolistique, trouveront les moyens de communiquer entre elles pour annuler les effets de leur séparation.
On ne sera pas surpris davantage de constater que le rapport ne sait pas quoi dire et proposer sur le sujet des « agences de notation » (p. 16).
La proposition que la règlementation financière soit confiée au pays hôte et non au pays d’origine (p. 17) sera considérée plus loin, dans le cadre de l’examen des relations Nord-Sud.
Le rapport Stiglitz n’offre aucune perspective de décision autonome pour les pays du Sud. L’idée même de cette autonomie est parfaitement étrangère à son concept orthodoxe libéral de la « mondialisation ».
Sans doute Stiglitz fait-il la concession apparente de la nécessité du « traitement différencié des pays développés et des pays en voie de développement » (p. 20) et invite-t-il les premiers à « ouvrir leurs marchés aux exportations du Sud » (p. 9). En fait, cette concession se résume dans l’esprit de sa formulation à l’octroi de quelques années « de traitement de faveur », puisqu’il souhaite ouvertement la conclusion du cycle de Doha (p.9) qui ne prévoit rien de plus. Le rapport affiche une ignorance totale et sans doute méprisante à l’égard des critiques sévères et justifiées à l’endroit de l’OMC, pour lesquelles nous renvoyons le lecteur aux analyses dévastatrices de Jacques Berthelot et de Via Campesina, concernant le traitement des productions agricoles et alimentaires. Le rapport ne signale même pas les contre propositions faites par des groupes de pays du Sud.
Au demeurant l’insistance sur l’ouverture du Nord aux exportations du Sud, conçue comme la voie royale de développement par l’orthodoxie libérale, élimine d’emblée l’examen d’une autre voie, fondée sur la priorité donnée à l’élargissement du marché interne des pays du Sud (individuellement et collectivement) et sur la réduction relative de leurs exportations vers le Nord.
La question grave de la dette extérieure de certains pays du Sud ne donne lieu dans le rapport qu’à une proposition de « moratoire quand la dette est trop lourde» (p. 19). L’examen des analyses de la dette qui ont établi son caractère spoliateur, souvent immoral, et la revendication d’un audit de cette dette et de l’élaboration d’un droit international digne de ce nom dans ce domaine sont également parfaitement ignorés.
Stiglitz est resté ce qu’il était – un fonctionnaire de la Banque Mondiale à laquelle il n’a jamais adressé que des critiques mineures. C’est pourquoi les propositions de « gouvernance démocratique » de ces institutions (p 13) se limitent pour lui à l’association de quelques pays émergents à leur administration, dans la tentative d’en faire les complices du Nord qui restent en position de domination maîtresse de ces « agences » (en fait leurs agences de la gestion de la mondialisation).
Quelques propositions du rapport concernant le FMI peuvent donner l’illusion que Stiglitz invite à davantage. Par exemple, la proposition « d’achever l’émission de DTS approuvée par le FMI (en 1997 !) » (p. 6). Mais celle-ci ignore que, par les règles qui gouvernent cette émission, ce sont les pays les plus riches (en particulier ceux du Nord) qui en seront les bénéficiaires majeurs, tandis que les montants qui pourraient faciliter les règlements des pays pauvres du Sud demeurent insignifiants.
Stiglitz ne remet pas en cause les principes fondamentaux qui régissent la conditionnalité associée aux interventions du FMI quand bien même signale-t-il la nécessité d’atténuer leurs effets « pro-cycliques ». Le FMI reste ce qu’il est : l’autorité de gestion coloniale des monnaies des pays du Sud, auxquels s’ajoutent désormais ceux de l’Europe de l’Est. Les interventions récentes du FMI en Hongrie et en Lettonie en illustrent la réalité.
Sans doute Stiglitz semble-t-il reconnaître le droit légitime des pays du Sud à gérer leur compte capital (p. 8), voire à « contrôler les flux financiers » (p. 17). L’invitation faite à donner la priorité à la législation (libérale quand même, bien entendu) du pays hôte plutôt qu’à celle du pays d’origine des institutions bancaires – signalée plus haut – s’aligne sur ces concessions. Mais on pourrait faire observer que sur ces points Stiglitz ne fait qu’inviter le FMI à retourner aux principes qui furent les siens et n’ont été abandonnés, tard dans les années 1990, que sous la pression des libéraux dogmatiques extrémistes. Comme on pourrait observer que la résistance de la Chine, qui refuse toujours la libération financière mondialisée, est pour quelque chose dans cette rare note de réalisme politique du rédacteur du rapport.
Toujours est-il que Stiglitz reste sur les positions de l’orthodoxie libérale extrême qui refuse de remettre en question le principe des changes flexibles. Dans ces conditions, il est douteux que la proposition qu’il retient – à savoir « l’élargissement des DTS » (p. 12) – ouvre la voie à la substitution d’un instrument de réserve international « nouveau » à l’usage dominant d’une monnaie nationale (en l’occurrence le dollar) comme monnaie de réserve internationale. Les autorités chinoises, elles, ont effectivement amorcé une évolution dans cette direction par des accords passés avec quelques partenaires du Sud. Et même si dans l’état actuel ces accords ne concernent qu’une fraction minime du commerce de la Chine (5 %), ils n’en demeurent pas moins l’exemple de ce que le Sud peut faire, sans chercher à obtenir un « consensus global » (c'est-à-dire l’approbation du Nord) qui l’y autorise. Les accords de l’ALBA et de la Banco Sur s’inscrivent dans cet esprit, bien qu’ils n’aient pas encore donné lieu à une mise en œuvre effective importante.
Finalement la proposition de Stiglitz de mettre en place un « Conseil de Sécurité Economique » (le « Conseil Mondial de Coordination Economique ») demeure dans ces conditions ambigüe. S’agit-il de dresser un obstacle supplémentaire aux droits légitimes des pays du Sud de décider par eux-mêmes des formes de leur participation à la mondialisation, en imposant le « consensus global » ? On peut le soupçonner. Comme on peut soupçonner que si, par hasard (par malheur pour Stiglitz et ses collègues libéraux) les pays du Sud tentaient de mettre l’institution au service de leur propre concept du développement, ne verrait-on pas ceux du Nord en marginaliser le rôle, comme ils l’ont fait avec l’ONU, la CNUCED, le Conseil Economique et Social et bien d’autres institutions quand elles échappent à leur contrôle unilatéral ?
Les propositions de Stiglitz constituent un ensemble cohérent qui traduit une vision rigoureusement orthodoxe libérale.
La lecture du chapitre 2 de l’excellent ouvrage rédigé par Jean Marie Harribey et Dominique Plihou pour ATTAC (Sortir de la Crise Globale ; La Découverte 2009) permet de mesurer l’ampleur du désastre que représente le point de vue réactionnaire de Stiglitz tant au plan social qu’à celui du type de relations internationales qu’il implique.
Ces auteurs écrivent (p. 35) : « La financiarisation n’est pas un facteur autonome, elle apparaît comme la contrepartie logique de la baisse de la part salariale et de la raréfaction des occasions d’investissement suffisamment rentables. C’est pourquoi la montée des inégalités sociales (à l’intérieur de chaque pays et entre zones de l’économie mondiale) est un trait constitutif du fonctionnement du capitalisme contemporain ».
Or l’objectif de Stiglitz n’est autre que précisément de remettre en marche ce système, et de restituer à la financiarisation les fonctions décrites par ATTAC. Stiglitz fait le choix d’une société de plus en plus inégalitaire, aux plans nationaux et au plan mondial, annihilant par là même ses belles phrases concernant la « réduction de la pauvreté ».
Ce choix est celui de l’establishment des Etats Unis dans son ensemble, dont Stiglitz est le fidèle défenseur. Car en effet le modèle en question (« inégalités sociales et internationales associées à la financiarisation ») est le seul qui permette aux Etats Unis de maintenir leur position hégémonique. D’une double manière. D’une part, par ce qu’il permet de substituer à la carence de la demande, associée à la surexploitation du travail, une dynamisation par l’endettement. Et d’autre part, parce qu’il permet de financer le déficit extérieur des Etats Unis par son ouverture à la mondialisation financière.
Comme l’écrivent les auteurs de l’ouvrage d’ATTAC : « la règlementation de la finance est un remède nécessaire, mais qui ne peut suffire … La financiarisation se nourrit de la baisse de la part salariale et des déséquilibres de l’économie mondiale. Pour dégonfler la finance, il faudrait donc fermer ces deux robinets … ce qui implique une autre répartition des richesses et une autre organisation de l’économie mondiale » (p. 41).
Or, précisément, ni l’establishment des Etats Unis, ni Stiglitz, l’un de leurs plus fidèles serviteurs, n’acceptent la fermeture de ces robinets. Car la fermeture du robinet qui, par le canal du déficit extérieur des Etats Unis, alimente l’expansion du marché financier importerait la crise sociale mondiale aux Etats Unis même. C’est pourquoi la crise est, comme je l’analyse, une crise double, à la fois du capitalisme tardif des oligopoles et de l’hégémonie des Etats Unis, ces deux dimensions de son déploiement étant indissociables. Le choix que Stiglitz défend est, de ce fait, inacceptable et, dans un horizon temporel bref ou moins bref, sera remis en question par la reconquête de l’autonomie de décision des pays du Sud qui en sont les victimes majeures.
Le modèle réactionnaire de « sortie par le haut » de la crise « financière » et de double restauration de la domination mondiale brutale des oligopoles et de l’hégémonie des Etats Unis, préconisé par Stiglitz n’est certainement pas le seul possible. Il est même probablement le moins réaliste, même s’il répond au souhait des administrations successives de Washington et, par la force des choses, des gouvernements subalternisés de l’Europe atlantiste.
Il existe une autre famille de propositions de « sortie par la haut », préconisées par d’autres économistes tout également conventionnels mais néanmoins préoccupés de mettre en œuvre un plan de réformes conséquent du capitalisme mondial. Qu’on les qualifie de « keynésiens », ou de « néo-keynésiens », ou autrement importe peu.
Les inégalités sociales croissantes ne sont alors pas acceptées comme « le prix fatal nécessaire du progrès », mais au contraire analysées comme le produit de stratégies du capital des oligopoles, organisant les conditions qui lui sont favorables (la fragmentation du travail et la mise en concurrence internationale des travailleurs). Ces stratégies sont à l’origine de la longue crise de l’accumulation qu’elles perpétuent. La crise en cours n’est donc pas une crise conjoncturelle en V mais une crise longue en L. Un grand plan de relance axé sur la réduction des inégalités pourrait alors transformer le L en U.
Le plan est audacieux, il doit l’être. La nationalisation (point de départ d’une socialisation possible) n’est pas exclue (en particulier pour les institutions financières). La stabilisation des prix des valeurs mobilières autour de 50 % des prix artificiels et fabuleux que la financiarisation avait permis n’est pas considérée comme un désastre, mais au contraire comme une opération de purge saine. Faire reculer la marchandisation des services sociaux (éducation, santé, logement, transports publics, sécurité sociale et retraites) est conçu alors comme nécessaire et obligatoire. Un accroissement massif et durable de l’intervention publique, voire – pour le moyen terme des années à venir permettant la transformation du L en U – un accroissement des déficits publics enregistrés (ce qui vaut à ce plan la qualification de « keynésien »), n’est pas davantage considéré comme catastrophique. La « reprise » concerne alors en priorité l’économie productive, marginalisant l’impact des marchés financiers.
Le plan est voulu mondial, mais s’inscrit dans la perspective d’une mondialisation négociée, permettant aux différents pays et régions de la planète (Europe inclus) de favoriser en priorité leurs marchés internes et régionaux. Des stratégies de soutien systématique aux économies paysannes deviennent alors possibles et constituent la bonne réponse à la crise alimentaire. Les défis écologiques peuvent alors tout également être traités sérieusement, et non plus contournés par les oligopoles. Le plan mondial comporte son volet politique, qui s’ouvre par le renforcement des institutions et du droit internationaux. Il s’inscrit dans la vision d’une « mondialisation sans hégémonie ».
On aurait aimé voir les Nations Unies prendre l’initiative de propositions s’inscrivant dans cette perspective. C’est après tout le rôle que cette institution doit jouer.
L’erreur grave est de rechercher le « consensus global ». Car dans l’état actuel des choses un consensus authentique est impossible et la poursuite de cette chimère revient à s’aligner sur le G 7 réactionnaire, se substituant, comme le langage de tous les jours l’illustre, à « la communauté internationale ». Au demeurant une bonne partie des propositions de Stiglitz
avait déjà été adoptées par le G 7, déguisé en G 20. Sans que pour autant beaucoup des pays du Sud convoqués pour l’occasion, et d’autres qui ne l’ont pas été, n’aient témoigné un grand enthousiasme. Ils ont avalé la pilule sans grande conviction.
Mais si les choses sont ainsi cela signifie que le chaos du système mondial n’est pas en voie d’être dépassé. Au contraire, le monde est engagé sur le chemin d’un chaos toujours grandissant. La meilleure réponse alternative passe par le renforcement des chances d’une reconquête de l’autonomie du Sud, sans, pour le moment, chercher à convaincre le Nord par un faux « consensus ».
Post Scriptum
Le « draft outcome document of the Conference » préparé pour l’Assemblée Générale des Nations Unies réunie du 24 au 26 Juin 2009 confirme notre jugement sévère du « rapport Stiglitz ».
J’ignore ce que fut le rôle du rédacteur choisi par les puissances de la triade (le néerlandais Frank Majoor), et n’exclus pas qu’il se soit employé à diluer davantage le rapport Stiglitz, déjà insignifiant. Ce qui en a résulté est donc un texte sans portée, qui égrène les vœux pieux sans souci de formuler les conditions nécessaires pour leur mise en œuvre.
La recherche à tout prix d’un « consensus global » (paragraphe 6) est à l’origine de cette faillite annoncée. Car les puissances de la triade ne poursuivent encore qu’un seul objectif : faire entériner par les pays du Sud en désarroi leurs décisions unilatérales, elles mêmes conformes à la plus parfaite orthodoxie libérale, et rien de plus. La seule réponse qu’on puisse opposer à ce diktat doit être fondée sur l’abandon de la poursuite de ce faux consensus. Les pays du Sud doivent donc se donner les moyens d’agir à leur tour unilatéralement, aux plans nationaux et autant que possible régionaux comme à celui du groupe de 77 + Chine. Construire un « Bandung 2 » en dehors de tout faux consensus doit constituer l’objectif du combat de leurs peuples, nations et Etats.
Note :
Cette critique concerne le rapport préparé par une commission désignée par le Président en exercice de l’Assemblée Générale des Nations Unie, Padre Miguel D’ Escoto, et présenté à cette même Assemblée, réunie du 24 au 26 juin 2009. Le professeur Stiglitz, président de la commission avait visiblement imposé ses vues personnelles. L’Assemblée de l’ONU, à peine signalée par les médias, a donc essuyé un « échec ». En réalité une victoire des pays du Sud qui, en s’abstenant de se faire représenter au niveau requis, ont manifesté par là même leur refus d’entériner les décisions unilatérales du Nord, seules retenues dans le rapport.
* Samir Amin est membre du Conseil international du Forum social mondial et président du Forum mondial des alternatives.
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 748 lectures